Dans l'essai Sauve-toi la vie t'appelle (Odile Jacob), vous développez ce que vous aviez révélé publiquement en 2010 dans un opuscule, Je me souviens (Editions L'esprit du temps) : raflé par la Gestapo à l'âge de 6 ans, vous vous êtes caché dans les toilettes de la synagogue de Bordeaux, puis, orphelin et balloté au gré des familles d'accueil, avez survécu et bâti une grande carrière scientifique. Ce sas de soixante années vous séparant de l'indicible et que vous avez traversées dans le silence était-il indispensable à la catharsis ?
Ces années ne furent pas celles de « mon » silence, mais celles, conjuguées, de la surdité et de la peur caractéristiques de mon entourage. Enfant, j'ai toujours parlé, mais personne n'entendait. On raillait ou niait mes confessions, qui n'entraient pas dans la culture du moment. Alors, j'ai fini par me taire. Puis la parole s'est progressivement dégelée parce le climat propre à accueillir des histoires comme la mienne s'est simultanément réchauffé.
Je me souviens était un verbatim dont l'écriture puis l'incroyable succès m'ont un peu échappé. Il appelait une seconde rédaction, celle-ci très personnelle, qui prenne mon histoire pour objet de science à partir duquel je devais investiguer le contenu et la réalité de ma mémoire. C'est alors que je suis reparti sur le chemin de mon histoire, et ai retrouvé les lieux, les archives, les témoins.
L'écriture participe, de votre propre aveu, au deuil...
Elle est une manière d'officialiser la mémoire. Mais elle n'est pas la seule. Les médias, qui font partie des récits collectifs au même titre que les romans, les films, ou les pièces de théâtre, ont la même vertu. Comment ne pas me souvenir de cette ballade en montagne, avec des amis, bien avant la publication de ces deux livres. Je leur raconte mon enfance. Quelques années plus tard, Patrick Poivre d'Arvor m'invite publiquement à l'évoquer sur un plateau de télévision. Et ces mêmes amis de me téléphoner alors et de s'étonner que jamais auparavant je ne leur avais confié cette tragédie.... Ecrire peut tout changer. Enfant, j'étais « chose » : on m'a arrêté, enfermé, persécuté, poussé à m'évader, on a brisé ma famille ; en écrivant, je n'étais plus « chose » mais « moi », et ainsi j'ai pu reprendre un peu possession de mon monde intime. Je suis redevenu « sujet » de ma parole.
Primo Levi écrivit son chef d'?uvre, Si c'est un homme, dès la fin de la guerre. Son expérience des camps de la mort, il avait éprouvé le besoin de la partager presque instantanément. Quarante ans plus tard, il se suicidait. Sam Braun, de son côté, attendit une cinquantaine d'années avant de rédiger Personne ne m'aurait cru alors je me suis tu et de témoigner dans les lycées. Votre silence face à l'indicible, face aussi aux terribles suspicions qui planaient à la Libération, la préservation de cette « crypte » au sein de laquelle vous vous êtes reconstruit, vous ont-ils préservé d'un funeste destin ?
Primo Levi avait fait le choix de raconter son expérience de la déportation dès 1947. Jorge Semprun confia qu'il avait voulu écrire dès le lendemain de la guerre mais qu'alors ses brouillons « saignaient » et qu'il s'exposait bien davantage à entretenir qu'à cicatriser la blessure. Vingt ans plus tard, il décida de métamorphoser sa tragédie personnelle en roman. Ces deux trajectoires sont symptomatiques de ce qui différencie le témoignage (Levi) de l'écriture (Semprun). Le premier, au contraire d'ailleurs d'Anne Franck dont le célèbre journal était empreint d'une candeur, d'une simplicité, d'un récit qui le rendirent universellement « acceptable », rapporta un témoignage dont l'abomination n'était pas supportable au moment de la publication. D'ailleurs seuls 700 exemplaires furent vendus... Tout comme Elie Wiesel, il considérait inimaginable de ne pas témoigner de ce qu'il avait connu. Mais au contraire de Jorge Semprun ou d'Anne Franck, des décennies seront nécessaires avant que son récit soit « recevable » et entre dans la culture. Il est alors trop tard. Toute sa vie il fut seul. Seul à Auschwitz, seul après Auschwitz au retour duquel même sa s?ur s'avoua incapable d'entendre son témoignage. « Je suis seul », a-t-il toujours écrit.
Vous êtes l'incarnation des travaux de résilience auxquels vous vous êtes consacré dans votre carrière de neuropsychiatre. L'écriture de cet essai, l'auto auscultation et la « mise en public » de votre propre cas, ont-elles fait évoluer vos connaissances voire vos conclusions dans ce domaine ?
Je pense ne pas être un bon exemple de résilience. Car l'après-guerre fut, pour moi, plus redoutable encore. Enfant, mon monde était clivé, compartimenté. Binaire. Mon quotidien était partagé entre les « gentils » qui me protégeaient - les Justes, mes tuteurs - et les « méchants » - la Gestapo et la milice - attelés à me tuer. Cette représentation très manichéenne avait l'avantage d'être limpide. Au lendemain de la guerre, la France était dans le chaos. Ainsi, en trois ans, je connus une quinzaine d'institutions ; personne ne croyait mon récit, j'étais moqué, rejeté et donc incapable de trouver une place. Même les bourses d'études ne m'étaient pas accessibles, et je dus alors travailler très tôt. Ces épreuves furent finalement plus douloureuses car elles étaient à la fois moins visibles et totalement inexplicables.
La manière dont vous fûtes secouru, aimé, rassuré, considéré, mis en confiance par une partie de votre entourage et notamment vos tuteurs conditionna ultérieurement votre parcours. Elle démontre que la capacité résiliente dépend, chez l'enfant victime d'un traumatisme, de ce contexte affectif...
Cette problématique est fondamentale. En Afrique, en Asie, en Amérique du sud évoluent des sociétés dites - du point de vue occidental - « archaïques ». Certaines d'entre elles sont le théâtre d'abominations. Il en est, par exemple, de la République démocratique du Congo, frappée par une détresse économique, sociale, humanitaire considérable. Et pourtant, qu'y constate-t-on ? Souvent sans parents qui disparaissent pour espérer récolter quelques dollars ou pour seule nourriture de la canne à sucre, les enfants sont très bien entourés. Cornaqués par une « vieille » ou un moniteur âgés de 13 ans, ils font preuve de gaieté, profitent d'une éducation qui chez les plus riches passe par l'école et pour l'ensemble est apprentissage des chants, des rituels de politesse, de l'aide aux « anciens ». Nombre de petits garçons vont chercher l'eau le matin, récupèrent au sein des ONG les pastilles destinées à la rendre potable, assistent aux cours, puis le soir la distribuent aux plus vulnérables du village. Lesquels sont toujours assistés et secourus par la communauté lorsqu'ils défaillent. En France, élevons-nous mieux nos enfants ? Nous les réveillons à 6h30, les déposons à la crèche ou à l'école, les récupérons le soir suffisamment « crevés » - eux pour ne pas étudier, nous pour ne pas leur accorder l'attention suffisante. De plus, on les prive d'un éveil capital aux choses simples qui, comme la musique, le sport, les jeux, la création artistique, l'entraide, sont déterminantes dans leur construction.
Notre culture de la performance individuelle isole peu à peu les enfants de l'essentiel. Et cela, même la neuro-imagerie le démontre. Ainsi chez les enfants dits « isolés » lors des derniers mois de la grossesse ou des premiers mois de la vie, le fonctionnement du cerveau est altéré. L'absence de stimulation et les carences sensorielles ont un effet à double détente : immédiat, avec l'atrophie du lobe frontal, et long-termiste, avec la difficulté plus tard de contrôler ses émotions.
Cette observation doit interroger fortement votre appréciation des modèles d'éducation dans la famille et à l'école, mais aussi, cette fois à l'égard des adultes et notamment dans le monde du travail, de l'enveloppe « sécuritaire » si déterminante dans la faculté résiliente....
Québécois et Scandinaves ont fait du développement des métiers de la petite enfance une priorité. Cette approche est clé, afin d'assurer aux enfants un contexte « sécure » qui épargne tout sacrifice professionnel chez les parents. En France, ce choix a été évincé. L'ancien gouvernement m'a abondamment sollicité sur ce sujet mais n'a pas agi ; le nouveau gouvernement, lui, ne m'invite même pas. Et assigne en justice l'université privée au sein de laquelle j'espérais développer l'enseignement de ces métiers...
Longtemps, dans les domaines de l'éducation comme du travail, évoluèrent des tuteurs, auxquels les apprentis pouvaient s'identifier, goûtant à la transmission des savoirs, construisant une échelle de valeurs et parfois même - ce fut votre cas - sculptant un idéal d'Homme. Ce système s'est délité... En mesure-t-on les dégâts ?
Cette érosion est indiscutable. L'un de mes amis est l'un des derniers grands luthiers français. Son extraordinaire savoir, ce métier à la fois de musicien, de sens, de main, d'art, il aimerait les transmettre. Mais il doit renoncer, faute d'élèves... L'expérience que conduisit Anton Semionovitch Makarenko est encore plus explicite et emblématique. Au lendemain de la Révolution russe, les rues étaient envahies de centaines de milliers d'enfants, orphelins, qui survivaient grâce aux délits. La répression policière se révéla inefficace. Ce pédagogue fonda alors des maisons coopératives. Objectif : occuper ces enfants, donner du sens à leur existence, les former à un métier, au sport, à l'art. Le fil conducteur ? La transmission de l'apprentissage. Ainsi, chaque « ancien » de 15 ans avait pour responsabilité de participer à la formation des plus jeunes. Chacun donc à la fois recevait et dispensait l'apprentissage. La délinquance juvénile fut jugulée, ces adolescents ayant trouvé une place dans la nouvelle société. La marginalisation du tutorat et, consubstantiellement, les entraves à la transmission, constituent désormais un obstacle dans la société.
Dans le champ de l'art domine un dogme (ou une réalité) persistant : la liberté émancipatrice et créatrice dépend de la capacité à s'affranchir de l'histoire de l'art, et même à rompre le continuum. Y souscrivez-vous ? Comment l'antécédent, qu'il prenne la forme de la mémoire ou du souvenir, doit-il être intégré à sa construction d'Homme ?
La mémoire est plurielle : biologique, affective, sociale, sémantique, d'images, etc. Une forme de mémoire empêche l'évolution de la création : celle dite des « perroquets », fondée sur une répétition mécanique de ce qui a précédé, prisonnière de son passé, et donc dépourvue d'esprit d'innovation. Cette logique sclérosante, qui amène les théories à se transformer en dogmes et exhorte l'individu à la médiocrité pour s'assurer la moins mauvaise des situations, domina aussi bien au sein du bloc communiste que dans le Japon d'avant la tragédie d'Hiroshima. Et, même en France, elle est toujours aussi puissante dans nombre de domaines professionnels. Ainsi, on peut davantage espérer faire carrière dans les métiers scientifiques si l'on sait répéter la voix du maître ou intégrer les critères à partir desquels son travail pourra être produit dans une revue scientifique. Alors qu'émettre une innovation « dérange », et donc exclut desdites revues et entrave la progression au sein de la hiérarchie.
Qu'il s'agisse d'un individu ou d'une nation, l'enjeu est de conserver la mémoire sans pour autant s'y enfermer au risque alors d'hypothéquer l'avenir. La mémoire de la Shoah inexorablement va s'effacer. Bientôt, plus aucun survivant ne pourra témoigner et maintenir le lien vivant, réel, visible avec cette barbarie. Etes-vous inquiet, à l'aune du racisme ambiant et notamment d'un antisémitisme qui était endormi et semble se réveiller au moment où la crise exhorte à se recroqueviller, à avoir peur, à stigmatiser ?
« Si on oublie le passé, on répète le passé ». Ce postulat est-il systématique ? Je ne crois pas. Conserver la mémoire est essentiel, mais proposer, bâtir, partager un rêve d'avenir l'est tout autant. Ces deux items sont indissociables si l'on veut donner les moyens de nourrir l'existence du plus sûr rempart à la barbarie : le sens. Sens sans lequel la vie est réduite à la quête, au plaisir, à la consommation aussi aveugles qu'immédiats. Comme chez les drogués. Là encore, l'innovation intervient de manière prépondérante. Employer le passé pour innover, à l'instar des romans de Jorge Semprun, est déterminant dans la constitution de ce sens et de ce rêve d'avenir. Il n'y a pas d'existence sans avoir préalablement saisi l'intérêt qui la nourrit. D'où, d'ailleurs, la responsabilité de stimuler chez les enfants et les adolescents la nécessité de féconder puis de fertiliser cet intérêt. Au risque, sinon, qu'ils s'adonnent aux activités extrêmes (sports à hauts risques, drogue, violence) à même de provoquer un événement, un plaisir aussi furtifs qu'absurdes et parfois même tragiques.
Mais justement, a-t-on su innover suffisamment pour assurer à la mémoire de la Shoah le sens nécessaire pour survivre à la disparition de ses témoins et pour endiguer le risque d'une répétition ultérieure ? Sans doute pas, si l'on se réfère aux massacres au Rwanda ou à l'autogénocide perpétré par Pol Pot...
Selon plusieurs témoignages, Adolf Hitler aurait déclaré à propos des juifs : « On peut les tuer tous ; qui se rappelle du génocide arménien ? ». Se taire signifie être complice des négationnistes. Pour autant, dire ne doit pas se transformer en inculpation, ou en règlement de comptes. « Je suis heureux, car chacun de mes livres sera comme un revolver braqué sur la tête d'un Allemand », s'exclama Primo Levi lorsque ses ouvrages furent traduit outre-Rhin.... La moins mauvaise méthode consiste à chercher à comprendre les racines et les mécanismes de la barbarie, et à s'affranchir des dogmes stéréotypés dans lesquels on enferme volontiers des événements aussi indicibles que l'extermination d'une population. On apporterait alors une vraie innovation...
Le contexte économique, social, sociétal, humain en 2013 assombrit les perspectives traditionnelles d'avenir, mais aussi ouvre à de nouvelles opportunités. Tout au long de votre existence, sont-ce ces rêves d'avenir qui vous ont permis de cheminer ainsi dans votre présent ?
Il est exact que la nature de ces rêves d'avenir résulte substantiellement du contexte social et culturel qui donne une lecture particulière de chaque situation éprouvée. Pour cette raison, la nécessité du sens dépend de la mémoire à condition de ne pas s'y soumettre et de l'employer utilement. C'est alors que d'une tragédie il devient possible de faire du beau. Dans le Radeau de la Méduse, Géricault n'élève-t-il pas le cadavre, même en décomposition, au rang d'art ? Picasso ne donne-t-il pas à l'insupportable massacre des civils de Guernica perpétré par les troupes franquistes une intensité inoubliable au travers de ces corps démembrés ou de ces gueules cassées ? Or actuellement, 80% des victimes des guerres sont des civils. Sans élever la moindre protestation publique. Preuve que les valeurs et les émotions dépendent beaucoup de l'environnement historique, culturel, et des récits.
Votre examen des comportements humains et individuels durant la guerre a dû mettre en lumière la force de frappe, terrible, que constitue le « groupe » dans le sillage duquel les actes les plus odieux mais aussi les plus insignifiants sont perpétrés. Cette expérience vous a-t-elle interrogé sur le périmètre et le fonctionnement de la démocratie ?
Absolument. Nombre de scientifiques qui, sur la base des archives remarquablement structurées et étayées par l'organisation nazie, ont étudié le phénomène de l'extermination de masse, ont conclu à la « monstruosité » des génocidaires. Cette thèse du mal absolu, je n'y souscris pas. Ces hommes et ces femmes sont, au contraire, « hyper normaux ». Ce sont de gentils pères et mères de famille, équilibrés, souvent érudits, et même sensibles, notamment à l'art. Rudolf Höss, directeur du camp d'Auschwitz, n'avoua-t-il pas avoir passé de bien belles années en bordure du camp, auprès de sa femme et de ses trois enfants chéris, construisant chaque jour une forme de fraternité avec ses complices nazis ? Simplement, tous ont en commun d'être soumis à la loi indiscutable d'un chef qui obstrue leurs facultés de discernement. Chef qui peut être religieux ou laïque, politique, philosophique, ou même scientifique.
Souvenons-nous de l'expérience du psychologue américain Stanley Milgram, effectuée au début des années soixante et reproduite plus tard en France par Jean-Léon Beauvois. Elle invitait un individu à envoyer des décharges électriques, sans cesse plus élevées, sur des cobayes humains complices de cette expérience d'apprentissage et qui simulaient la douleur croissante. L'objectif était de mesurer le degré d'obéissance à un ordre appliqué par une autorité jugée légitime, quand bien même il était contraire à la morale et affectait la conscience de celui qui l'exécutait. Les résultats furent dévastateurs, démontrant le don individuel pour la soumission.
Vous avez échappé à la mort parce que vous avez désobéi - aux injonctions des soldats qui vous avaient parqué dans la synagogue. Cette désobéissance vous a accompagné tout au long de votre existence. Elle constitue même, confiez-vous à Acteurs de l'économie en 2010, l'un des substrats des plus grandes découvertes scientifiques. La normatisation, l'uniformisation, le conformisme, l'endogamie caractéristiques de la société donnent-elle encore le droit de désobéir ?
Les détails de l'expérimentation de Milgram sont, à ce titre, explicites. Environ 20% des participants refusent, à un moment, de poursuivre l'expérience et de se soumettre à l'ordre maléfique. Même face aux pressions qui s'exercent sur eux, même face à l'imparable argumentation liant leur geste à l'intérêt de la victime, au respect du contrat qu'ils ont signé, ou à la perspective de rémunération, ils maintiennent leur position. Ces « insoumis » ont-ils quelque chose en commun ? Oui. Tous sont de mauvais élèves, ont pratiqué l'école buissonnière, bref sont des désobéissants.
Le nazisme fut l'incarnation paroxystique de la servilité. Quelles sont les formes modernes de vassalisation et les alternatives qui en découlent ?
Le choix est difficile. Se soumettre au chef, quel qu'il soit, assure individuellement de faire carrière et collectivement de prolonger le fonctionnement ; désobéir entrave ledit fonctionnement de la société. Sans doute est-ce une limite de la démocratie.
N'existe-t-il pas la voie, médiane, d'une « désobéissance utile », celle qui a du sens pour l'autre et s'inscrit dans un projet d'intérêt collectif ?
Je ne crois pas. Ce qui se passe dans les pays arabes et particulièrement au Proche-Orient où j'interviens régulièrement est un exemple : les peuples se sont débarrassés d'une dictature de portefeuille et lorgnent désormais une dictature religieuse. Et s'ils optent pour la démocratie, ils s'exposent à un conflit constant.
Cette mémoire est devenue également un objet « marchand » de science, depuis que des laboratoires et des entreprises la traitent à des fins mercantiles dans le domaine de la neuroéconomie et du neuromarketing. Exploiter la connaissance scientifique de la mémoire et du souvenir, c'est-à-dire ce que l'individu porte en lui de plus intime, relève-t-il d'une instrumentalisation non éthique ?
Chaque découverte scientifique s'expose à ce danger, car le propre de la recherche est de n'être jamais définitif et d'ouvrir systématiquement à de nouveaux champs d'investigation. C'est un mouvement ininterrompu. Et dès qu'une idée scientifique entre dans la culture ou dans l'industrie, elle est aussitôt récupérée et transformée en dogme marchand. Ce fut le cas lorsque les tranquillisants ou l'électroencéphalogramme virent le jour. Ca l'est aujourd'hui ans le domaine de la psychanalyse, où fleurissent de pseudos diplômes grâce auxquels de pseudos professionnels peuvent s'installer, dispenser de pseudos compétences mais engrangent de véritables recettes. Lors d'un congrès révélant des travaux portant sur les interactions précoces (baptisées trivialement communication intra-utérine), une spectatrice a simultanément sollicité un laboratoire américain pour mettre au point un appareil destiné à stimuler les f?tus. Le projet commercial était enclenché avant même la fin du congrès....
Cela signifie-t-il qu'intrinsèquement l'éthique de la découverte scientifique ne peut qu'être défigurée par les systèmes marchand et libéral ?
La faute n'est pas propriété d'un seul camp. Les scientifiques eux-mêmes portent leur part de responsabilité. Eux aussi se laissent pervertir, moins pour l'argent que pour l'avancement dans leur carrière ou la mise en lumière d'une idée. Les acteurs marchands ne sont pas plus immoraux que les scientifiques. De plus, ils sont soumis à un critère de validation objectif : lorsque les produits qu'ils commercialisent sont inefficaces, la sanction est immédiate ; de leur côté, les scientifiques n'ont que la carrière pour critère de validation.
Echapper à l'indicible qui a précipité dans la mort ici des millions de personnes, là les passagers d'une voiture ou les voisins d'un immeuble en feu, questionne la culpabilité, et donc l'environnement appelé à délester de ce poids. La société a-t-elle progressé dans ce domaine ou au contraire n'est-on pas soumis dans le quotidien à une multiplicité de coercitions culpabilisantes ?
Seules les sociétés « perverses », qui comme celles des nazis et des communistes sont fondées sur le dogme totalitaire, échappent à la culpabilité. En effet, tout ce qui affecte les réfractaires, les récalcitrants, les étrangers dudit dogme, est minoré voire balayé. Quelle est la valeur d'une vie lorsque celle-ci n'est pas considérée par le dogme dominant ? La culpabilité est un moyen précieux de vivre ensemble. Elle est une garantie éthique, que connaissent aussi bien la civilisation judéo-chrétienne que son alter ego musulmane. Grâce à la culpabilité - et cela quel qu'en soit le terreau : religieux ou humaniste -, « on » ne peut pas tout se permettre. Elle est un rempart à la faute, à l'irrespect d'autrui, à la barbarie.
« Je suis condamné à mort pour un crime que je vais commettre, et parce que je suis juif », confiez-vous. Ce sentiment a nécessairement participé plus tard à votre double conception de la justice. Est-il intervenu dans votre appréciation, contrastée, du procès Papon, mais aussi dans vos engagements, notamment en Palestine, à accompagner des enfants punis d'être nés « ainsi » et « là » ?
Absolument. Avec l'enfance que fut la mienne, je suis difficile à soumettre à une idéologie. Par exemple, lors de mes interventions en Palestine, en Israël, ou au Liban, je suis exposé aux représentations que mes interlocuteurs se font des camps adverses ; cela, j'en suis incapable : je les regarde uniquement pour ce qu'ils sont eux-mêmes, intrinsèquement, en tant que femme ou homme. Jamais pour l'identité ou la cause dont ils sont censés être le drapeau. Leur douleur, je l'ausculte pour ce qu'elle est, je ne l'examine pas dans le prisme des affres belliqueux, racistes, ou économiques dont elle est issue et qui pourraient m'amener à prendre une position. Il est vraisemblable que cette posture constitue une trace de mon enfance.
La France de cette petite enfance est celle qui à la fois vous a traqué et protégé, anéanti et secouru. Elle fut le théâtre de la pire inhumanité et de la plus belle humanité. Comment cette expérience a-t-elle nourri plus tard votre conscience politique, mais aussi « refermé à l'âge de 16 ans » une carrière politique initiée « deux ans plus tôt » ?
Au lendemain de la guerre, l'une de mes cousines, dont les parents avaient été tués, déclara : « Je ne resterai pas dans ce pays, qui a été le théâtre et s'est rendu complice d'une telle barbarie ». De mon côté, je rétorquais : « Ce n'est pas vrai : ce pays nous a protégés. Les « vrais » Français ont pris notre parti ». Cette cousine, installée depuis en Israël, et moi avions une interprétation diamétralement opposée d'une même situation, nous avions aussi une manière de « sentir le monde », de « goûter au monde », elle aussi antithétique. Voilà à quoi la guerre a exposé chacun d'entre nous. Et à la Libération, dans un pays que l'idéologie communiste avait envahi au point qu'une belle culture populaire caractérisait le monde ouvrier - naissance du TNP, profusion de lecture, de théâtre, de cinéma, mais aussi plus simplement de débats dans les bistrots après les douze heures de labeur quotidien -, l'engagement politique était omniprésent. Si je m'en suis très vite affranchi, sans bien sûr éteindre ma conscience politique, c'est que j'étais résolument incapable de me laisser enfermer dans une croyance - quelle qu'elle soit : religieuse, scientifique, politique - et de me soumettre à un dogme ou à une idéologie nécessairement totalitaires.
Comment votre propre histoire interroge-t-elle la capacité à se défaire du déterminisme social et culturel et à s'écarter du chemin qu'il pave, la distinction entre l'identité subie et celle que l'on cisèle soi-même ?
L'individu se construit sous une double pression, en interaction constante : celle de la biologie et celle du regard social. Il est exposé à une transaction continue entre ce qu'il est et ce qui est autour de lui - structure familiale, cadre social, éveil culturel, et même les récits que colportent les « fabricants » de mots et qui participent aux stéréotypes, aux préjugés, et finalement à la structuration de soi. Pour reprendre l'exemple de ma judéité, effectivement je suis juif alors qu'enfant - et aujourd'hui encore ! - j'en ignorais même la signification. Peut-être s'agit-il là d'un avatar de l'inné et de l'acquis, cette dualité qui est entrée dans la culture alors que sur un plan scientifique elle ne correspond strictement à aucune réalité. Connait-on une seule trace génétique dite innée qui serait imperméable au milieu dans lequel elle évolue ?
« J'ai traversé la mort, elle est devenue une expérience de ma vie », écrivez-vous. Le rapport de l'Homme à la mort diffère dans l'histoire. Quel est-il en 2013, dans une société singularisée par le délitement spirituel, les nouvelles techniques médicales, les débats éthiques, la pression de la performance, de la perfection et de l'image ? Comment cette appréhension de la mort conditionne-t-elle la manière de s'en saisir pour construire sa vie ?
On ne peut qu'imaginer ce qu'on a été avant la vie, on ne peut qu'imaginer ce que l'on sera après. Puisque personne n'a eu l'opportunité d'en relater l'expérience, la mort ne peut-être qu'une représentation, que conditionne la culture à laquelle on est lié. Des cultures, notamment en Asie ou en Afrique, considèrent même une filiation jusqu'au culte des ancêtres. Avec pour interprétation qu'avant la naissance nous serions « dans » nos parents ou nos grands-parents, et avec pour conséquence la grande difficulté d'accepter l'adoption. En effet, comment accueillir un enfant dont on ignore la filiation ? Au Congo, les jeunes orphelins, dits « serpents », sont frappés d'ostracisme ; leur origine étant inconnue, elle est sujette aux pire supputations - viol - et leur construction, leur avenir sont donc entravés par le regard social qui les humilie et les condamne. Dans l'Egypte et la chrétienté anciennes - au contraire des juifs, moins soucieux du sujet -, on a toujours abondamment bâti pour honorer la mort et surtout l'après.
Alors certes ces représentations ne sont plus les mêmes en 2013. Pour autant, il serait toujours aussi insupportable de ne pas traiter comme il se doit le corps d'un défunt aimé, et le recours aux rituels ou aux sépultures demeure inchangé afin de maintenir vivant dans la mémoire celui qui n'est plus dans le réel. Grâce à cela, on aime encore celui qui n'est plus là. On est même obligé de penser sa vie après sa mort. D'ailleurs, pour cette raison, c'est sans doute des sépultures que sont nées les premières ?uvres d'art. Supprimez la souffrance et la mort dans les ?uvres d'art, et vous fermez le Louvre, détruisez l'immense majorité des romans ou des grandes pièces de musique.
C'est également au creux du déséquilibre, de la défaillance, des traumatismes, que se nichent les trésors d'humanité, d'empathie, d'altruisme et de créativité, la découverte de son identité ou l'élévation de sa conscience. Le droit à la vulnérabilité et au doute, la reconnaissance de la blessure ou de l'échec régressent-ils aujourd'hui ?
Dans les pays hiérarchisés, les pauvres souffrent car ils pensent être à leur place. Ils ont accepté leur condition et se sont résignés. Or ce qui caractérise souvent leur appréciation de la pauvreté et donc de la vulnérabilité ici teintées de soumission à l'inéluctable, c'est qu'ils les correllent à la vertu. Et mécaniquement associent l'enrichissement à la suspicion et à l'amoralité. « S'il est riche, c'est parce qu'il a commis des crimes ; si je suis pauvre, c'est parce que je n'ai jamais voulu fauter ».
Certaines vulnérabilités doivent être acceptées. D'autres, en revanche, doivent être combattues. Et particulièrement celles qui résultent de conditions culturelles ou sociales et qui détruisent autant l'individu que son environnement. Mais là encore, c'est souvent le contexte qui fabrique les vulnérabilités. Longtemps être ouvrier fut une fierté. Nombre d'entre eux ne lisaient pas Nietzche mais en revanche étaient maîtres dans l'art de travailler le bois, le métal, ou le verre. La société les reconnaissait dans leur savoir, leur spécialité ou leur science. Ils pouvaient être fiers d'eux-mêmes, ils possédaient une estime d'eux-mêmes qui les protégeaient de la vulnérabilité. Puis la société a fait le choix de discréditer peu à peu leur travail, leur utilité, leur place.
Le secret et sa préservation constituent des briques essentielles à la construction de son intimité et, au-delà, de soi. Est-il encore possible de les sanctuariser, y compris au sein de l'entreprise, dans une société dominée par la dictature de la transparence et par l'exhibitionnisme ?
Il y a une vingtaine d'années, la « mode » était à supprimer tout secret. Il ne fallait rien cacher, notamment aux enfants sous peine sinon de fabriquer quelques décennies plus tard une génération de psychotiques. Quelle absurdité.... Au sein des couples ou des familles, on ne compte plus les tragédies provoquées par la révélation de secrets. Je me souviens de deux s?urs, nées d'incestes qu'elles pressentaient mais que le déni de la famille avait claquemurés et enfouis. Grâce à ce double déni protecteur - le leur consolidé par celui de leur entourage -, elles avaient réussi à se construire affectivement, professionnellement et socialement. Jusqu'au jour où, au nom de cette sacro-sainte transparence, elles apprirent la terrible nouvelle. L'une d'elles, alors biologiste, ne put supporter cette révélation d'être née hors culture, d'un acte aussi monstrueux. Elle sombra dans les bouffées délirantes. Alors non, on ne peut pas tout dire.
Le secret trouble mais la révélation du secret détruit. Les sociétés qui veulent tout savoir portent le symptôme totalitariste. A l'aune de l'Inquisition ou, au XXème siècle, des pays nazis ou communistes, cette culture exigeait bien plus qu'un comportement social et humain vassalisé : l'inféodation de l'âme. On ne se contentait pas de sujets soumis dans leur seule attitude : on réclamait la sincérité et l'intégralité de leur servilité. C'est l'accomplissement ultime, la perfection même du totalitarisme.
Hier, le traumatisme avait pour décor la guerre, la déportation, la torture, la famine. Aujourd'hui, il a pour cadre le chômage, l'appauvrissement, le déclassement social, la solitude.... L'individu est désormais exposé à une succession de « mini-traumas ». Peut-on comparer leurs manifestations ? Ne faut-il pas hiérarchiser la légitimité de ces traumas et juguler la dérive victimaire qui semble s'être emparée de la société ?
Les traumatismes insidieux délabrent parfois davantage que les tragédies spectaculaires. Plusieurs travaux menés en France et au Québec démontrent que la précarité professionnelle, sociale, financière des parents - notion à distinguer de la pauvreté - est de nature à détruire la niche sensorielle des enfants et à altérer sensiblement leur développement. Cette précarité, par la faute de laquelle « on » change de travail ou de lieu de vie tous les mois, retire aux parents toute perspective long-termiste, et aux enfants la stabilité affective nécessaire à leur construction. Autrefois, le travail paysan, ouvrier, ou minier était dur. Mais il avait un mérite : celui d'assurer au foyer, à la famille, et particulièrement aux enfants un toit pérenne et donc une utile stabilité.
Les traumatismes collectifs coalisent ceux qui en sont victimes. Mais aujourd'hui, nonobstant quelques cas isolés dans le domaine de l'entreprise - comme chez Lejaby ou chez Arcelor Mittal -, la nature et les manifestations traumatiques semblent être à l'image de la société et de l'organisation des entreprises : morcelées, individualisées, isolées....
Effectivement. Riposter aux effets délétères de ces traumatismes insidieux réclame du soutien. Autrefois, les ouvriers pouvaient compter sur une mobilisation et une organisation collectives indiscutables, grâce auxquelles ils faisaient individuellement face. Ces ouvriers étaient des héros familiaux ou sociaux, fiers de leur identité. En l'occurrence, le socle que constituait le syndicat était essentiel pour cimenter ce soutien. Aujourd'hui « on » est ouvrier faute de mieux, faute d'opportunités. Et l'instabilité qui caractérise les emplois, les entreprises, et donc les carrières démunit. Jusqu'à affecter toutes les formes de solidarité et de reconnaissance. Comment s'étonner alors des phénomènes de rejet et notamment de racisme ?
Ce qu'est la société en matière de solidarités, de structure familiale, mais aussi de cadre politique ou de services publics altère-t-il le « tissage du lien social », la capacité d'entendre, d'accueillir, d'accompagner les citoyens en souffrance et donc de « renforcer » ceux en processus de reconstruction ?
Les formes de solidarité ne sont en effet plus les mêmes. Il y a quelques décennies, la solidarité était palpable jusque dans la rue. Cette solidarité de familles générait une formidable entraide, qui prenait la forme d'une mutualisation des forces humaines profitant à tous. Cette structure de groupe, grâce à laquelle on aidait le voisin à bâtir sa maison, on partageait fêtes, mariages, enterrements du quartier, avait pour mérite de sécuriser. Et à l'époque, le corps « faisait » social, c'est-à-dire qu'il était interdit pour les hommes de se plaindre sous peine, sinon, de rentrer honteux dans le foyer. Cela, sous le joug de la précarisation, de l'instabilité, de la féminisation, et de la transformation des représentations du travail, n'existe plus.
Cette société parvient-elle à souffler sur les braises des deux besoins résilients que forment celui de comprendre et celui de rêver ? La formidable complexité du monde entrave-t-elle ce dessein ?
La population est scindée en deux : la moitié d'entre elle adore l'incertitude, la complexité des possibilités, l'aventure de la décision ; l'autre moitié déteste ce contexte, car il l'angoisse. Elle réclame des certitudes, et pour cela peut être même prête à accepter n'importe quel chef - religieux, politique. N'oublions pas que les dictatures d'Hitler hier et de Morsi aujourd'hui résultent de processus démocratiques. Pourquoi d'aucuns aiment tant la dictature ? Parce qu'elle écarte les doutes, rassemble d'une seule voix, épargne les arbitrages, bref apporte tranquillité, certitude, sécurité. Elle permet d'éprouver le bonheur dans la servitude. Or qu'est-ce que l'aventure de la personne s'il n'y a pas de doutes, de choix, de décisions ?
« La vie est passionnante parce qu'elle est folle », rappelez-vous. Mais le champ autorisé, reconnu, encouragé de la folie semble bien exigu...
Le XIIIème siècle marque un tournant. Jusqu'alors, le groupe était tout puissant, et l'identité individuelle réduite à sa portion congrue, confinée dans un périmètre dicté par la maison, le village, l'église, le champ. Au nom de la morale, on punissait même celui qui osait s'affranchir du groupe. C'est alors qu'apparaît la notion de personne. Les gens commencent à s'individualiser, à se démarquer du groupe, à exposer des vêtements, des projets, des idées qui les singularisent. C'est donc à ce moment que surgit la notion de folie, dont on affuble ces « errants » qui osent vivre en dehors du groupe et innover. Au début jugés hérétiques et jetés au bûcher, on commence peu à peu à ne plus les tuer, on les considère fous car « hors société », « hors humanité ». Finalement, cette notion de folie est consubstantielle à l'amélioration de la possibilité de l'aventure de la personne.
Grâce aux progrès de la technologie et des droits de l'homme, la société est parvenue au XXIème siècle à admettre plus volontiers la pression du groupe, et ainsi à valoriser le développement et l'aventure des personnes. Alors surgissent de vraies personnalités - artistiques, scientifiques, entrepreneuriales - qui cessent de penser comme tout le monde, peuvent affirmer et faire reconnaître leur singularité, leur sens de l'innovation.
Le processus résilient octroie une force, insoupçonnée. C'est pourquoi il s'applique à l'acte entrepreneurial. Avec toutefois pour danger qu'avec le succès il prenne les atours de l'invincibilité et de la sacralité, mais aussi, face aux obstacles, ceux et du déni ou de la cécité ....
Il faut quand même être gonflé pour être entrepreneur ! Admiré et craint, surtout lorsqu'il résulte d'un processus résilient dans le cadre duquel il s'est montré plus fort que la mort et est « re-né » de ses cendres, il est héroïsé. Il est aussi simultanément poussé au sacrifice. A ce triptyque admiration-crainte-sacrifice qui caractérise le statut de héros, on constate in fine que les entrepreneurs sont eux-mêmes candidats.
L'hypersensibilité symptomatique des personnes en résilience est-elle compatible, chez les entrepreneurs, avec l'effroyable dureté et les implacables arbitrages qui s'imposent à la gestion et au management des sociétés - la souffrance psychique est sans doute particulière chez les entrepreneurs résilients en grande difficulté professionnelle ?
Nous pouvons établir un parallèle d'avec ce que nous observons en médecine. Des enquêtes ont été menées sur le burn-out, c'est-à-dire la dépression liée à un épuisement professionnel, en fonction des spécialités et des services (urgence, maladies chroniques, etc.). Il apparaît que la probabilité de dépression croît parallèlement au degré de difficulté des contacts humains inhérents au poste occupé et au métier exercé. En d'autres termes, dans un même service de cancérologie, si plus de la moitié des médecins ou infirmiers au contact « humain » des malades sont vulnérables au burn-out, une très faible proportion des mêmes professionnels attelés à une pratique essentiellement technologique (radiographie, établissement d'un diagnostic, etc.) et peu exposés au plan humain, connaît le même sort. La technologie protège parce qu'elle éloigne les relations humaines. Pour les mêmes raisons, les entrepreneurs dits résilients sont eux-mêmes sans doute plus vulnérables lorsque la situation de leur entreprise ou la nature de certaines décisions mettent en jeu leur hypersensibilité.
Cette hypersensibilité façonne-t-elle des entreprises davantage « humaines », innovantes, productrices de sens ?
Là encore, ce que nous avons étudié dans le domaine de la médecine peut être appliqué au monde des entrepreneurs. Et les conclusions posent une lourde interrogation éthique. En effet, on a constaté auprès des chefs de service que leur vulnérabilité progressait au fur et à mesure qu'ils établissaient des relations humaines élevées. Doivent-ils alors, pour se protéger, se désengager de cet investissement humain et managérial ?
Qu'ont donc en commun ces médecins hospitaliers qui recourent abusivement à la technologie, se noient dans l'administratif, multiplient les examens, et finalement passent de moins en moins de temps auprès des malades ? Que partagent donc ces psychiatres qui noient leurs patients de médicaments ? La solitude, source d'une vulnérabilité qu'ils compriment en se distançant de ce qui provoque l'angoisse et ainsi en érigeant à l'égard de l'objet même de leur vocation un rempart qu'ils espèrent salvateur. Or la réalité est tout autre. Comme chez les entrepreneurs, cette digression, cette esquive ne sont qu'un pis-aller, et généralement la réalité s'aggrave. La clé pour tisser une relation humaine, c'est d'être en confiance.
Nota bene : Cette interview est également publiée dans le numéro 111 de février 2013 d'Acteurs de l'économie.

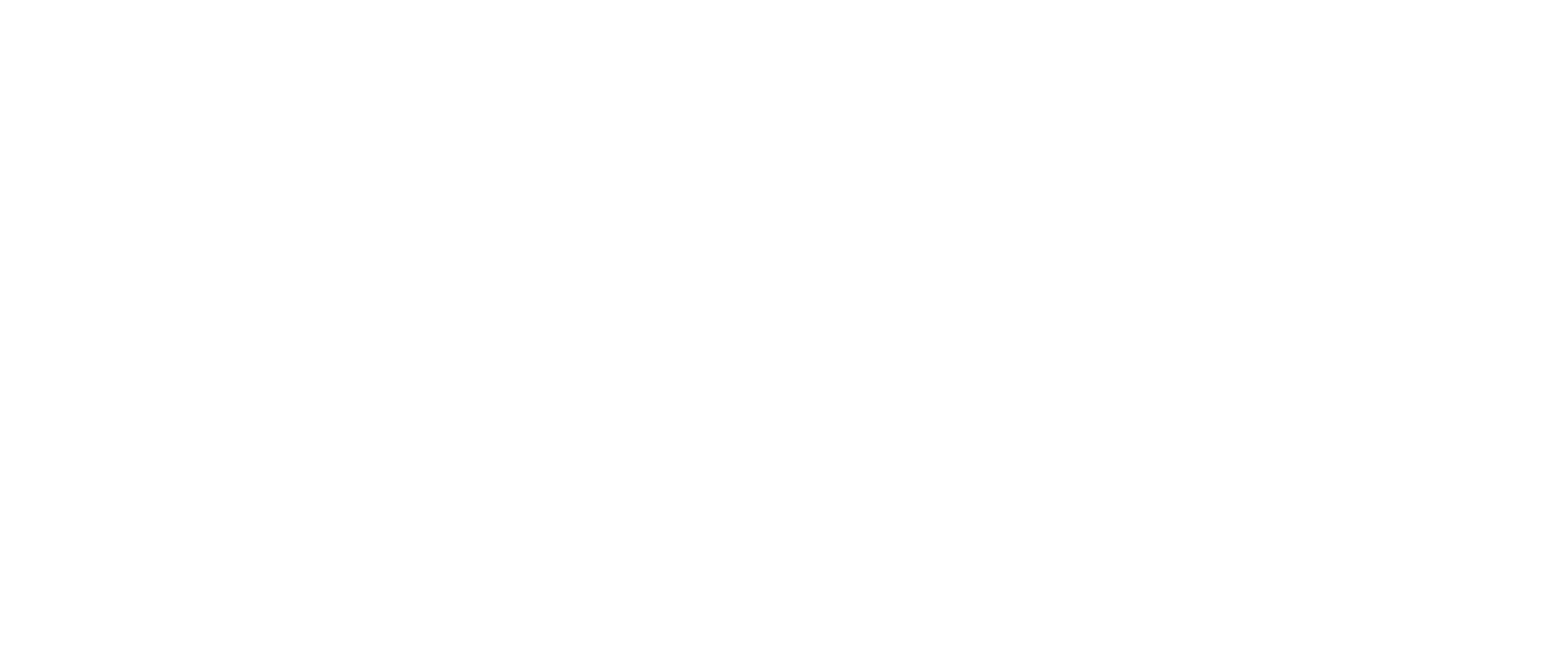
 Retraités : la volte-face des favorisés d'Emmanuel Macron (45)
Retraités : la volte-face des favorisés d'Emmanuel Macron (45)


Sujets les + commentés