
Il y a dix ans déjà, vous alertiez sur les tensions en matière de prix de l'énergie, les besoins en ressources induits par la transition énergétique, l'effondrement de la biodiversité... La situation actuelle n'est-elle pas le reflet de notre échec collectif ?
Philippe Bihouix En dix ans, ces sujets sont devenus « mainstream » et de nombreuses organisations internationales, comme l'Agence Internationale de l'Énergie, la Banque Mondiale, l'OCDE ou la Commission européenne, s'en sont emparées. Nous assistons maintenant à une lente prise de conscience ; ce qui était présenté comme des solutions évidentes - voitures électriques ou énergies vertes - s'avère complexe à mettre en œuvre. Il faut cesser de croire que l'innovation technologique constitue l'unique réponse. Suivant encore les préceptes de Francis Bacon, l'auteur de La Nouvelle Atlantide, nous évitons prudemment les innovations politiques et économiques qui seront pourtant, je crois, indispensables à la transition, complémentaires à l'innovation frugale. Je conserve néanmoins un certain optimisme face à la situation, car l'être humain est adaptable et résilient. Je reste convaincu que l'on peut modifier en profondeur nos modes de vie en l'espace d'une génération.
Les voitures électriques et les énergies vertes seraient donc le signe d'un certain manque de discernement ?
P.B. Je ne suis pas « contre » par principe, mais croire que les énergies renouvelables et les voitures électriques nous permettront de décarboner sans changer nos pratiques, sans consommer moins d'énergie, sans nous déplacer moins et autrement, est une dangereuse illusion. Il faut tout remettre en question : quels seront les modes de production, les usages ? Un moteur électrique s'use moins qu'un moteur thermique : va-t-on en profiter pour allonger la durée de vie des voitures, les conserver pendant trente ans, comme les avions, et en produire d'autant moins ? Quels modèles allons-nous autoriser et déployer ? Une voiture de 2 tonnes et 1 000 km d'autonomie nécessite 10 fois plus de batteries, donc 10 fois plus de matières premières, qu'une voiturette de 800 kg avec 250 km de rayon d'action. Même chose sur les usages des énergies vertes : si, en 2050, on installe des parcs d'éoliennes en mer pour alimenter des affichages publicitaires et fabriquer des capsules de café en aluminium, on aura raté un truc... Il faut nous inscrire dans une logique de civilisation, repenser les usages, le réemploi, la réutilisation, le recyclage, la façon dont nous organisons la vie et l'économie sur un territoire donné.
Qu'apportent les low-tech dans cette logique de civilisation ? Impliquent-elles de renoncer à la high-tech ?
P.B. Je considère les low-tech comme une démarche basée sur le « techno-discernement » et qui permet d'abaisser la consommation d'énergie et de ressources. L'objectif est d'abord de nous interroger sur les besoins, de mettre en œuvre une sobriété « systémique », ensuite de fabriquer des objets les plus durables et réparables possibles. Cette démarche est applicable à tous les secteurs. Des technologies de pointe resteront utiles, pour conserver des procédés industriels efficaces et économes par exemple - tandis que beaucoup d'objets du quotidien peuvent avoir une conception simplifiée -, ou dans certains domaines comme l'énergie, le médical... Les capteurs sont très utiles pour surveiller l'activité de certains réseaux ; en revanche, les capteurs dans les réfrigérateurs pour qu'ils fassent les courses en ligne le sont nettement moins... et ces capteurs seront peu ou pas recyclés. Adopter une démarche low-tech va donc demander des arbitrages entre la résilience d'une part et le « confort », la performance, l'efficacité, d'autre part.
Comment impulser de tels arbitrages ?
P.B. C'est une véritable évolution culturelle et industrielle et je pense qu'il faudra l'impulser par l'évolution des normes, de la réglementation, qu'il sera également nécessaire d'effectuer des rééquilibrages par la fiscalité, notamment entre le coût du travail et celui des matières premières et de l'énergie. Les ressources ne valent presque rien face au travail humain et cela limite les opportunités de réemploi, le recyclage correct, les réparations, car le coût de la main-d'œuvre devient vite plus élevé que le prix d'un produit neuf. Les cotisations salariales annuelles représentent environ 350 milliards d'euros par an, quand la taxe carbone, qui fait désormais si peur, est de quelques milliards. Il faudrait aussi mettre en œuvre un mécanisme de compensation aux frontières, sur de nombreux produits. Il ne s'agit pas d'être manichéen, de tout vouloir relocaliser et viser la fin des échanges mondiaux, de toute façon illusoire tant les chaînes de valeur sont intriquées, mais de soutenir des orientations économiques sans effets contre-productifs de la concurrence internationale.
La low-tech a donc d'importantes répercussions sociales...
P.B. Une partie des orientations sera presque indolore : on n'est pas plus heureux en changeant d'aspirateur tous les cinq ans ; on pourrait diviser par 100 l'impact environnemental du numérique en travaillant sur quelques leviers (formats des vidéos, taux de remplacement des équipements, mutualisation des réseaux, usages en mobilité, éco-conception des sites web...). Mais la sobriété impliquera forcément certains renoncements. La question sera alors celle de la juste répartition des efforts ; l'exemplarité des « élites » sera importante, on l'a vu dans le débat sur les jets privés l'été dernier. Cela nécessitera de cesser la propagande consumériste, de décider de nos priorités, de revoir le fonctionnement de la machine économique, qui encourage la surconsommation, la sur-technologie et génère des frustrations.
ACTUELLEMENT EN KIOSQUE ET DISPONIBLE SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

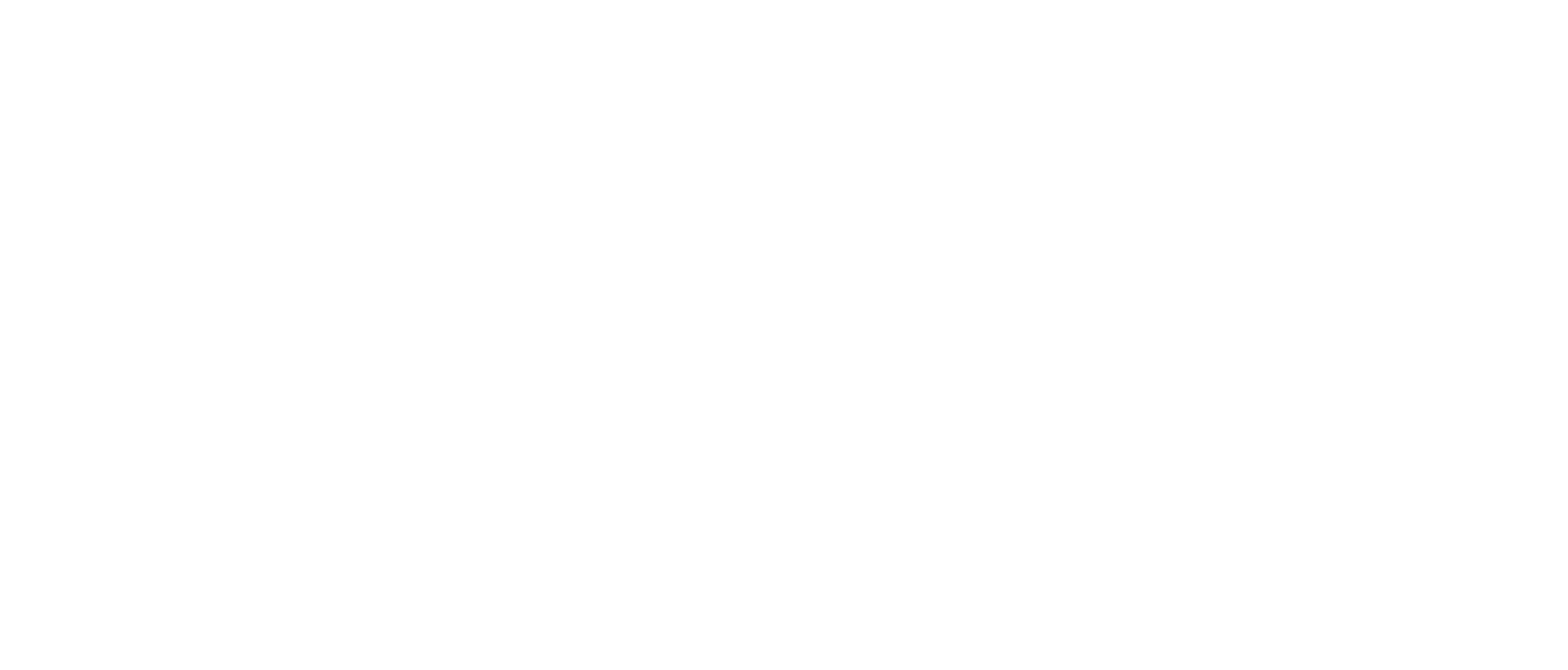

 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville

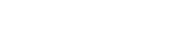
Sujets les + commentés