
LA TRIBUNE DIMANCHE - Est-ce parce qu'elle s'affranchit totalement des descriptions technologiques ? Point n'est besoin d'être férue de science-fiction pour être conquise par la délicatesse avec laquelle Emily St. John Mandel déchire l'espace-temps pour mieux se promener au cœur des profondeurs des êtres. Dans La Mer de la tranquillité, l'écrivaine canadienne réinvestit le vieux motif SF qu'est le voyage dans le temps en y insufflant de l'empathie, des points de suspension, de la poésie et de l'ambivalence. Ce roman postapocalyptique commence en 1912 et vous catapulte jusqu'en 2203 puis 2401. Seul point reliant ces trois époques, le bruissement d'un engin volant décollant au moment où se joue une berceuse au violon. On retrouve la romancière aux yeux jaune-brun dans un bistrot parisien, où elle arrive sans manteau - malgré le froid - mais avec sa petite amie et des rangers. Elle s'amuse à commander un café et de l'eau gazeuse dans un français plein de fossettes.
Il y a dix ans, au moment de la sortie en France de Station Eleven, vous fantasmiez à l'idée d'habiter à Paris. Est-ce toujours le cas ?
EMILY ST. JOHN MANDEL- C'était le temps où je n'écrivais que des romans. Maintenant que j'écris aussi pour la télévision, le décalage horaire entre Paris et Los Angeles est trop important... Et je suis bien à New York...
Dans La Mer de la tranquillité, votre double, l'écrivaine Olive Llewellyn, est en tournée mondiale sur la Terre. Et le pire, c'est la France. Vous racontez une scène à Lyon, lors d'un festival consacré au roman policier, où elle se retrouve face à une intervieweuse qui, sans un mot sur son livre, la soumet à un interrogatoire se finissant par cette question: « Sexe avec ou sans menottes ? » Olive quitte la pièce avant que la journaliste ait pu voir les larmes dans ses yeux. Est-ce une histoire vécue ?
En général, j'ai de bonnes expériences en France. Bon, c'est vrai, il y a eu, une fois, une expérience désagréable à Lyon... [Parce que le rire est le plus fin des diplomates, elle rit.]
Le paysage des littératures de l'imaginaire a été longtemps dominé par des hommes. Estce que vous ressentez une dette vis-à-vis de pionnières comme l'Américaine Ursula Le Guin, ou Margaret Atwood, canadienne comme vous ?
Ayant grandi au Canada, j'ai d'abord été sensible à Margaret Atwood. Bien sûr que j'ai une dette. Pour elles, ça a été bien plus difficile que pour moi. Aujourd'hui, même si on peut se plaindre du sexisme ou de remarques dans un festival, les romancières de science-fiction ont réussi à briser les carcans qui existaient entre la science-fiction et la fiction littéraire. Dans le genre, Ursula reste la reine...
Quels sont vos auteurs de science-fiction préférés ?
Il y en a deux. La Britannique Claire North, qui a écrit ce chef-d'œuvre de la dystopie qu'est 84K. Le Chinois Liu Cixin, qui pousse très loin la description technologique et scientifique, mais d'une façon que j'adore : il enchevêtre merveilleusement les explications sur les champs magnétiques, l'astrophysique, etc.
Ingénieur de formation, il fait de la « hard science » ; n'est-ce pas l'inverse de vous qui, dans ce livre, ne décrivez même pas le fonctionnement technique de votre machine à voyager dans le temps ?
Quand j'ai commencé à écrire La Mer de la tranquillité, j'ai passé quelque temps à travailler sur la physique quantique, puis je me suis rendu compte que je m'en fichais. Parce que c'est juste du transport. Je n'ai pas eu envie de décrire les moteurs de ces voitures du futur. Pas eu envie de consacrer des pages d'écriture à cela.
En montrant qu'on peut être un grand auteur de SF sans mettre les détails scientifiques au cœur de l'écriture, les femmes sont-elles en train de prendre le pouvoir ?
Quand j'étais enfant et adolescente, j'ai lu de la science-fiction de manière obsessionnelle, et d'abord l'écrivain russo-américain Isaac Asimov, qui était un scientifique, professeur de biochimie, et qui excellait dans ces détails. Quand vous écrivez de la science-fiction, il faut faire un choix et répondre à une question - sachant qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse : à quel point veut-on entrer en profondeur sur la dissertation de notre technologie future ? Comme la mécanique de manière générale m'intéresse peu, j'ai fait le choix de me concentrer sur les personnages. Je préfère passer du temps avec les gens plutôt qu'avec la technologie.
Vous faites dire à Olive : « Je suis convaincue que si nous nous tournons vers la fiction postapocalyptique, ce n'est pas parce que nous sommes attirés par le désastre en soi, mais parce que nous sommes attirés par ce qui, dans notre esprit, risque fort de se produire. Nous aspirons en secret à un monde moins technologique. »
Est-ce un message ?
C'est moins un message qu'une question. Depuis Station Eleven, j'ai beaucoup réfléchi à la question de savoir ce qui nous attire dans la littérature postapocalyptique. Il y a les injustices et les inégalités économiques qui donnent envie de faire tout exploser et de reprendre à zéro. Il y a aussi l'envie d'héroïsme : si jamais le monde venait à être détruit, il faudrait le reconstruire, et avec lui l'humanité, et donc une version meilleure et plus héroïque de l'homme. Il y a l'anxiété face au désastre écologique qui pousse à se demander ce qui se passerait après le chaos. Depuis que Cormac McCarthy a publié La Route [en 2006], ce qui a changé, c'est la technologie et le rapport à la technologie. Peut-être que je complique trop. J'éprouve une grande ambivalence vis-à-vis de la technologie. Je tiens pour un miracle la possibilité de communiquer en FaceTime avec ma fille de 7 ans à New York quand je suis à Paris. Mais d'un autre côté, le fait de passer notre temps collés à nos téléphones diminue notre espace mental, l'espace pour le déploiement de nos pensées, et notre intimité. Patrick Modiano en parle si bien dans ses romans.
Si le genre de la science-fiction postapocalyptique est en train de changer avec les femmes, est-ce seulement en raison du rapport à la technologie ? Les écrivaines n'ont-elles pas aussi un autre rapport à la violence ?
C'est vrai que le genre de la science-fiction postapocalyptique est en train de changer avec les femmes. L'écrivaine américaine Sloane Crosley a écrit il y a quelques années un article dans le New York Times dans lequel elle avance un argument intéressant : pour les femmes, le fait de se sentir menacée physiquement quand elles marchent dans la rue n'est pas particulièrement nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'elles ont envie de revisiter. De là, selon Sloane Crosley, le choix que font les écrivaines de s'intéresser davantage à l'humanité qu'à la violence physique et au chaos. C'est ce qui s'est passé pour moi dans Station Eleven : je n'avais pas envie de réécrire La Route. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui vient après.
Est-ce un « truc » de femmes de faire de l'empathie la clé de leurs romans ?
Sans doute. C'est ce que je fais. Il est plus intéressant à mes yeux de mettre l'accent sur les êtres humains que sur le chaos et de réfléchir à la façon dont les gens vont réagir et interagir dans des circonstances extrêmes plutôt que de décrire la violence.
Si vous vous tenez loin des dystopies grondantes ou dénonciatrices, vous trempez néanmoins votre plume dans une encre politique : au détour d'une phrase, on apprend que New York, comme le Texas, est autonome, et donc que les États-Unis sont désunis...
Et puis c'est tout. Pourquoi ?
En tant que lectrice, je n'aime pas que d'un seul coup l'écrivain vienne marteler un message qu'il impose à son lecteur. Mais je reconnais que la fiction est un moyen de faire des commentaires politiques. Il y a dans ce roman un commentaire implicite sur la fracture idéologique des États-Unis. Si vous saviez à quel point il est facile d'imaginer un futur où les États-Unis seraient devenus une série de petites républiques, théocraties et villes-États ! Il n'y a malheureusement pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination... [Elle soupire.]
Votre roman est construit autour de la question de la réalité et de la simulation. Olive considère qu'il n'existe « aucune douleur propre à l'irréalité. Une vie vécue sous un dôme, dans une atmosphère générée artificiellement, n'en reste pas moins une vie ». Plus loin, votre voyageur du temps Gaspery dira exactement la même chose : « Une vie vécue dans une simulation n'en reste pas moins une vie. » Faut-il comprendre que c'est ce que vous pensez ?
Absolument. La vie sous un dôme dans une colonie lunaire ou à Paris est la même. La vie, même en simulation, est une vie. Ce qui importe, ce sont les choix qu'on fait, et comment on se traite les uns et les autres. Ce qui est important, c'est la gentillesse et l'espoir.
Zoey, votre physicienne, finit par douter de la réalité du monde tel qu'il s'offre à elle et se demande si nous ne vivons pas tous dans un vaste exercice de simulation informatique. Toute réalité est-elle une simulation ? Est-ce une question qu'il faut se poser ?
Écrire un roman, c'est aussi faire une simulation, puisque l'on crée des gens, que l'on crée une situation et que l'on fait évoluer ces gens dans cette situation que l'on a créée. Ce n'était pas mon but premier d'écrire un roman sur le fait d'écrire un roman, mais c'est finalement ce qui s'est passé...
Vous avez évoqué Patrick Modiano. Dans son dernier roman, La Danseuse, il fait le parallèle entre la danse et la littérature, estimant que la littérature est « aussi un exercice difficile comme la danse ». Vous avez été danseuse jusqu'à l'âge de 22 ans. Diriez-vous comme lui ?
Je voudrais dire à Patrick Modiano qu'être une danseuse est plus difficile que d'être une écrivaine. [Sourire mutin.] Honnêtement et définitivement, écrire est moins difficile que danser. Mes pires jours en tant qu'écrivaine ne sont rien à côté d'une audition de danse. Imaginez que vous êtes dans une salle avec deux cents autres femmes, toutes en justaucorps avec un numéro sur le buste, en concurrence pour un seul job. [Yeux au ciel.] Je ne danse plus ; je préfère écrire. [Elle porte alors à son cou une main nue - ni vernis, ni bague, ni bracelet - découvrant un petit pendentif très très fin constitué de deux traits obliques qui se croisent en leur milieu.]
Ce bijou, le seul que vous portez, a-t-il une signification ?
C'est un baiser sur mon cou. [Au moment de se quitter, on aperçoit, sur le mini-sac noir qu'elle arbore à son épaule, un cygne blanc qui paraît glisser tranquillement.]

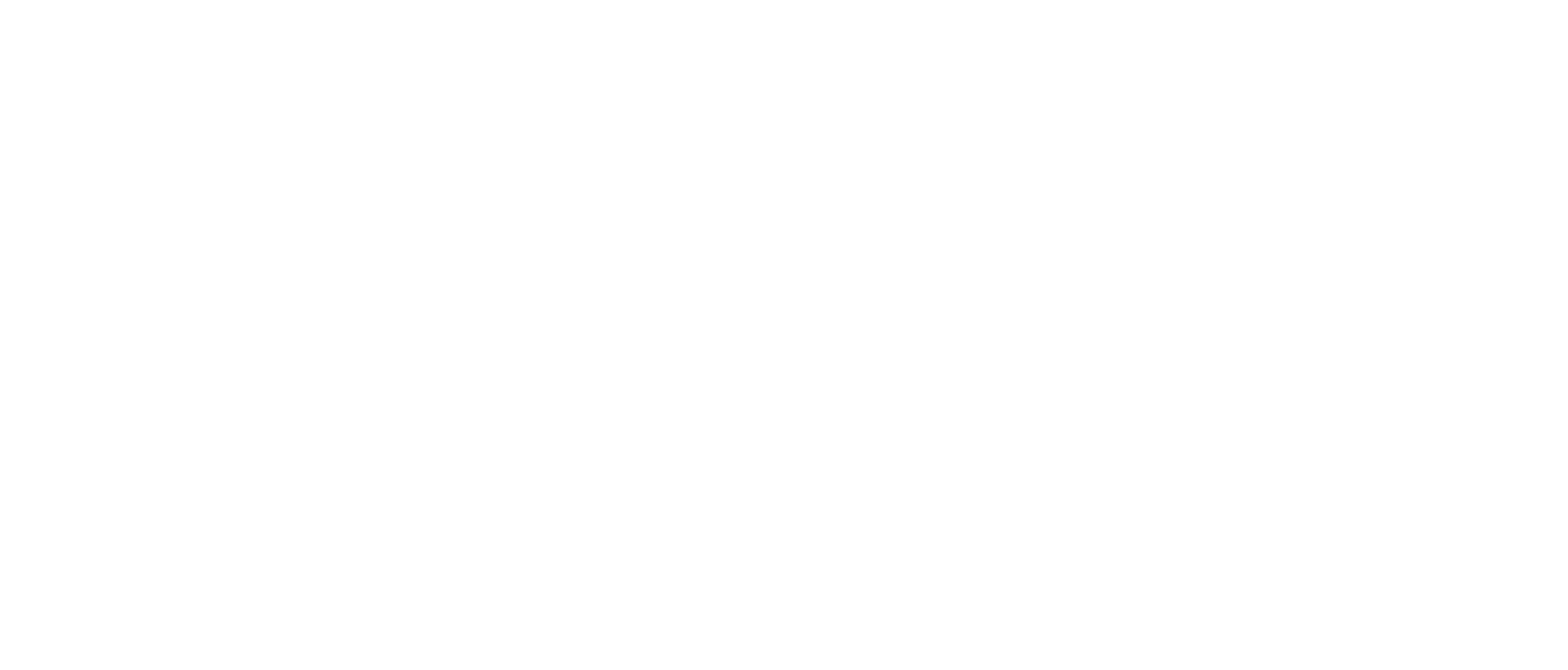
 Fraude aux prélèvements bancaires : pourquoi les données des clients français sont à la portée des escrocs
Fraude aux prélèvements bancaires : pourquoi les données des clients français sont à la portée des escrocs

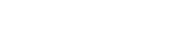
Sujets les + commentés