
Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la France, Emmanuel Macron a résumé, le 4 septembre dernier, la stratégie du gouvernement : « électrifier les pratiques », et ce « partout où on utilise du fossile », a-t-il affirmé dans un entretien avec le youtubeur Hugo Travers, alias HugoDécrypte. En d'autres termes : miser, lorsque c'est possible, sur les électrons plutôt que de brûler des hydrocarbures. Et notamment dans les bâtiments, où l'exécutif prône un changement des modes de chauffage, encore très dépendants de combustibles polluants. Récemment, la Première ministre, Elisabeth Borne, a même évoqué la possibilité d'interdire les nouvelles chaudières au gaz à l'horizon 2026...
...avant de rétropédaler fin juillet, sous la pression de nombreux acteurs du secteur. Et notamment du groupe Engie, qui freine l'électrification à tout-va du pays, de manière à promouvoir l'usage du gaz dans les logements. Quitte à contredire le plan de l'Etat afin d'atteindre la neutralité climatique, alors que la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), cette feuille de route pour baisser les émissions de CO2 dans chaque secteur, est actuellement en préparation.
Priorité aux logements
En effet, plutôt que de précipiter la fin des chaudières fossiles pour préserver le climat, Engie promet qu'en 2030, 25% du gaz utilisé dans ces installations sera du « biogaz », une molécule principalement composée de méthane, issue de la fermentation de matières agricoles et de déchets organiques. Pourtant, dans un document de travail publié en juin 2023, le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE), cette instance placée sous l'autorité de la Première ministre, fixe un objectif de 15% « seulement » d'incorporation de cette source d'énergie renouvelable pour les besoins en gaz des bâtiments d'ici à la fin de la décennie. Une « hypothèse ambitieuse » qui demandera déjà des « efforts très importants », peut-on lire dans la note soumise à concertation.
Alors, comment expliquer une telle différence ? Pour défendre sa vision, Engie a affirmé vendredi 8 septembre que ce biogaz devra aller « en priorité » aux logements, plutôt qu'à la mobilité ou l'industrie. De quoi justifier le maintien, voire l'installation de chaudières au gaz dans le principal poste d'utilisation de ce combustible fossile en France. Avec une rhétorique bien huilée : ce n'est pas le moyen de chauffage qu'il faut changer massivement, mais le combustible...
« Les scénarios d'Engie sont différents [de celui du SGPE, ndlr], et incluent le maintien de chaudières, notamment de THPE [des chaudières à gaz haute performance, ndlr], et de pompes à chaleur hybrides électricité-gaz. Le SPGE, lui, est plutôt sur un scénario pompes à chaleur électriques », explique-t-on dans l'entreprise.
Ressources limitées
Et pour cause : l'accès à ce fameux « méthane renouvelable » restera très limité d'ici à 2030. Au global, selon un autre document de travail de SGPE, 44 TWh (térawattheures) de biogaz seront injectés dans le réseau français à cette échéance, pour compléter quelque 184 TWh de gaz fossile (contre environ 7 TWh de biogaz et 350 TWh de gaz aujourd'hui).
« Si l'on arrive à produire 40 TWh de méthane renouvelable, ce sera déjà bien ! », commente Christian Couturier, directeur général de l'association Solagro, à l'origine d'un scénario sur la biomasse mobilisable pour l'énergie en France d'ici à la moitié du siècle, baptisé Afterres2050.
Sur ces 44 TWh, une quinzaine de TWh seront ainsi fléchés vers le chauffage des bâtiments, en plus de 93 TWh de gaz fossile, estime le SGPE. Soit environ un tiers du volume total disponible.
Des objectifs trop ambitieux ?
Or, pour Engie, la moitié du biogaz généré en France devra alimenter les logements d'ici à la fin de la décennie. D'autant que l'entreprise retient, comme base de son calcul, un volume total supérieur à ce que prévoit le gouvernement : ce ne sont pas 44 TWh, mais 60 TWh de biogaz qui seront injectés dans le réseau gazier français en 2030 (dont 5 TWh produits par Engie), promet l'énergéticien - dont 30 TWh pour les bâtiments, donc.
De quoi faire peser un « risque de lock-in technologique », c'est-à-dire un « verrouillage du recours à une solution en (grande) partie fossile [les chaudières à gaz, ndlr], qui nécessiterait pour 25 années supplémentaires le maintien des infrastructures correspondantes de distribution de gaz nature », alerte-t-on au think tank le Shift Project. Et pour cause « le risque est fort que la production de biogaz ne soit pas au niveau attendu en 2050 », avertit le groupe de réflexion dans une récente note.
De fait, si l'objectif de 60 TWh n'est pas atteint, et que 44 TWh sont injectés au total (comme le prévoit le SGPE dans le meilleur des cas), environ 68% du total du biogaz serait dédié à chauffer les bâtiments, selon les hypothèses d'Engie. Ce qui laisserait des miettes à d'autres secteurs, qui auront pourtant besoin de la fameuse molécule pour se décarboner.
Bataille entre secteurs
Et notamment ceux sans possible conversion à l'électrique, contrairement au chauffage des bâtiments. Car le biogaz devra également se substituer au pétrole dans certains usages de l'industrie ou de la mobilité lourde, pour lesquels les batteries ne seront pas adaptées. « La biomasse et les gaz verts sont des ressources rares et seront aussi nécessaires dans d'autres secteurs [...] plus difficiles à décarboner », pointe ainsi le SGPE dans sa synthèse.
« Il y a une bataille en cours. L'industrie, par exemple, voudrait utiliser du biogaz pour décarboner de nombreux procédés à haute température. Mais aussi le transport maritime, qui consomme aujourd'hui 500 TWh, soit à lui seul l'intégralité du gaz renouvelable qui pourrait être produit en Europe d'ici à 2050 ! Il serait dangereux de les abandonner pour réserver le biométhane aux seuls logements », estime Christian Couturier.
Une nouvelle feuille de route en préparation
Mais pour Engie, le secteur des transports devra se contenter des restes. « Sur les 30 TWh restants [hors utilisation dans les bâtiments, ndlr], on vise plutôt l'industrie en priorité, et un peu de mobilité », précise un porte-parole à La Tribune. Une vision que ne partage pas Christian Couturier, pourtant administrateur du CLER et membre de négaWatt, deux associations signataires d'une lettre envoyée début juin au gouvernement contre l'interdiction trop précoce des chaudières à gaz.
« Mieux vaut utiliser le biogaz dans la mobilité lourde que dans le chauffage des bâtiments, où il existe d'autres solutions adaptées. Certes, on ne peut pas installer de pompe à chaleur électrique partout, mais on peut aller très loin sur l'électrification des logements, moyennant une rénovation en amont ! », affirme-t-il.
« Une partie du gaz vert sera produit trop loin des réseaux et devra être utilisé directement (carburant, par exemple). Ceci doit conduire à annoncer largement que les usages diffus dans le bâtiment ne seront pas prioritaires, à l'instar du SGPE », ajoute par ailleurs le Shift Project dans la note susnommée.
Reste à voir quel signal enverra finalement le gouvernement, alors que les ventes de pompes à chaleur électriques air-eau, destinées à remplacer les chaudières à gaz, subissent une nette baisse par rapport à 2022 en raison de l'inflation et de la complexité des aides. L'exécutif devrait en tout cas actualiser, dans les tous prochains mois, la trajectoire précise de décarbonation des bâtiments, via une nouvelle version de la SNBC. Mais aussi ses objectifs de production de biogaz à horizon 2033, à travers la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Une chose est sûre : pour défendre la place du gaz, Engie ne restera pas les bras croisés.

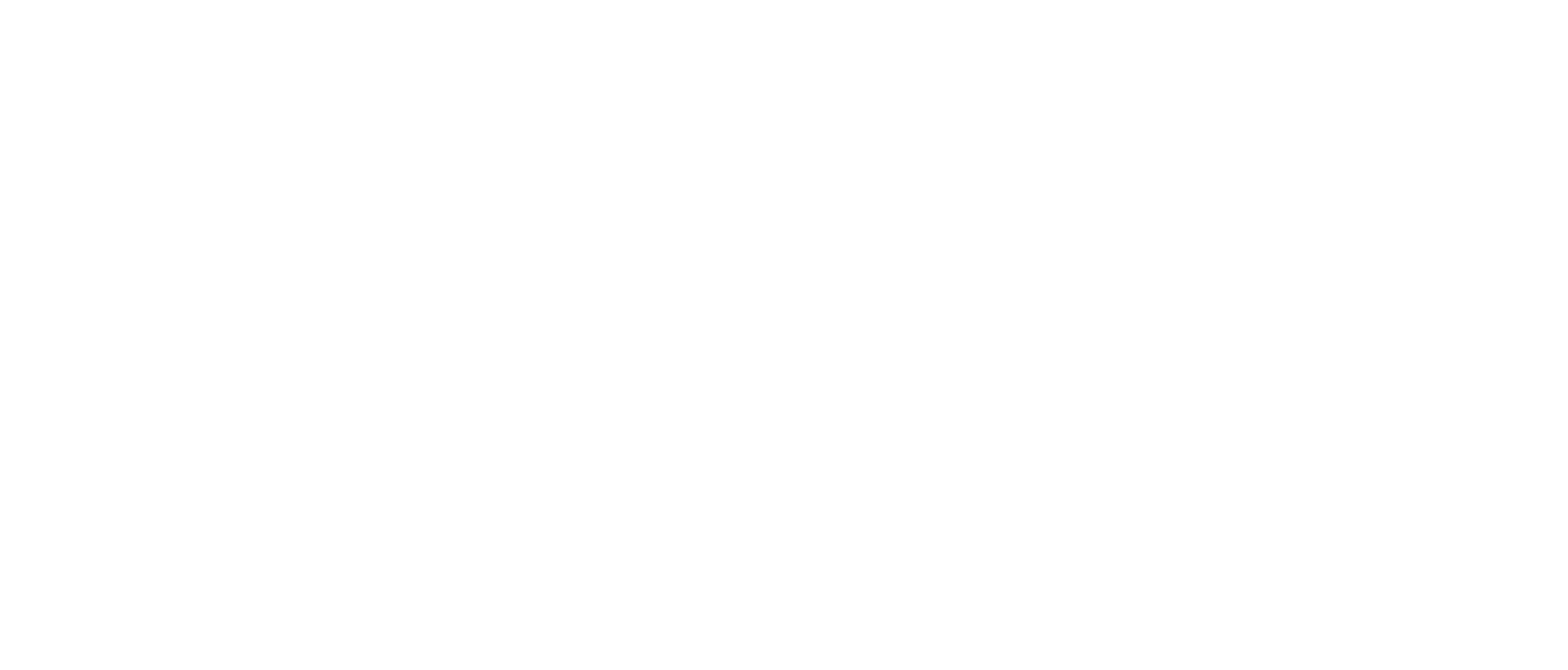

 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville

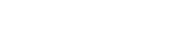
Sujets les + commentés