
C'était dans l'air depuis quelque temps déjà. C'est devenu une obsession depuis mars 2020 : depuis que la Covid-19 a ralenti, voire paralysé les échanges commerciaux, le made in France est revenu en force. On se souvient toutes et tous de la pénurie de masques et de gel au début de la pandémie et d'avoir même frôlé celle du paracétamol. La peur est immédiatement entrée dans les foyers entraînant dans son sillon des affolements légitimes. La peur. Cette grande menace pour nos écosystèmes. Car si le made in France était déjà au coeur des préoccupations des marques, des consommateurs et des publicitaires avec des arguments implacables certes : en achetant français, on préserve nos emplois et la planète, en bref, on consomme responsable et durable ; cette apologie patriotique du made in France soulève néanmoins quelques questionnements. D'abord, qu'est-ce qu'un produit made in France en réalité ? Car à considérer la chaîne d'assemblage d'un produit manufacturé, il y a peu de chance d'en trouver qui soit complètement français. Pas si simple de fabriquer tout sur place.
Certains entrepreneurs se sont pourtant lancés avec succès dans la fabrication française en créant leur propre marque, allant même jusqu'à concevoir de nouvelles matières fabriquées dans l'Hexagone. Et puis, il y a les entreprises qui ont décidé de relocaliser. Une aventure pour beaucoup, un vrai parcours du combattant pour d'autres ! Quand certains réussissent pleinement leur retour, d'autres se confrontent à l'imbroglio administratif et législatif et finissent par s'y casser les dents. Enfin, il ne faudrait pas s'imaginer que tous reviennent pour la bonne cause patriotique ; dans certains cas, c'est tout simplement parce que la délocalisation n'a pas tenu ses promesses. Quant à la création d'emplois par la relocalisation, selon les spécialistes, rien n'est moins sûr.
Pour autant, un certain nombre de régions en ont fait leur combat, et à raison ! Car ne nous y trompons pas : la réindustrialisation et la relocalisation sont des atouts précieux pour la relance. Le made in France, ce n'est pas juste une tendance marketing fructueuse ou une mode assumée par les consommateurs qui sont les premiers à le plébisciter. Ce consensus est réel. Prudence toutefois : économistes et experts de la mondialisation mettent en garde contre un emballement qui pourrait s'avérer être le fameux miroir aux alouettes.
Car si le premier réflexe face à la peur générée par la crise sanitaire et économique, c'est de se protéger, le protectionnisme a bien évidemment ses limites dans un monde globalisé. Tout produire en France ? Avoir un seul fournisseur ? Est-ce bien raisonnable si l'on veut éviter la dépendance ? Ne vaudrait-il pas mieux diversifier la source des approvisionnements comme le martèle l'économiste Isabelle Mejean dans notre long entretien et défendre une souveraineté qui soit stratégique ? Ne vaudrait-il pas mieux instaurer un nouvel équilibre d'interdépendance plus équitable, ou bien subventionner les investissements des entreprises plutôt que l'acte de relocalisation en lui-même comme le défend Nicolas Bouzou dans son texte inédit pour T ?
Et si, comme l'évoque François Roche dans son dossier dédié à l'histoire de la mondialisation, celle-ci n'était tout simplement pas en train de changer progressivement de nature ? Car force est de constater que la circulation des services et des idées a pris le pas sur les échanges de biens. Allant même jusqu'à observer une nouvelle forme de mondialisation : celle du combat pour la planète.




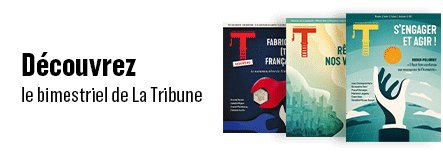
 Retraités : la volte-face des favorisés d'Emmanuel Macron (45)
Retraités : la volte-face des favorisés d'Emmanuel Macron (45)


Sujets les + commentés