
Que représente pour vous le concept d'engagement, en général et plus spécifiquement dans l'univers de la santé ?
Jean-Christophe Rufin Mon grand-père était médecin généraliste au tournant du xxe siècle. Et, pour lui, médecine et engagement étaient fortement liés. Pendant la Première Guerre mondiale, il a exercé sur les champs de bataille dans des conditions terribles. Durant la Seconde Guerre mondiale, il faisait partie d'un réseau de résistance à Bourges, près de la ligne de démarcation avec la zone libre. Il recueillait des aviateurs anglais. Il a été dénoncé et a passé deux ans à Buchenwald. Donc pour moi, l'engagement, c'est la médecine, et la médecine, c'est l'engagement.
Jeune médecin, vous faites votre service militaire en Tunisie où vous officiez dans des conditions précaires. Votre désir d'aider les plus vulnérables est-il né à ce moment-là ?
J-C.R. Jusque-là, j'avais été confronté à une médecine très technique dans les grands hôpitaux parisiens. Là-bas, je me suis retrouvé dans une maternité extrêmement mal équipée où on pratiquait une médecine pratiquement de guerre. Je suis passé d'un intérêt scientifique pour la médecine à une pratique plus humaine où le facteur culturel était prédominant.
De retour en France, vous participez à l'aventure de Médecins Sans Frontières, un concept inédit à l'époque. En quoi cette nouvelle forme d'engagement a-t-elle été importante pour vous ?
J-C.R. À la différence de la Croix-Rouge et des organismes régis par le droit, nous nous sommes focalisés sur la notion de justice et sur l'opinion publique, avec des débuts très médiatiques. Je les ai rejoints en 1974, trois ans après la création de MSF à la suite du conflit du Biafra au Nigeria. Cette année-là et les suivantes, il y a eu une série de crises internationales avec des dégâts humanitaires considérables : les boat-people au Vietnam, le Cambodge avec les Khmers rouges, des changements de régime au Mozambique, en Angola, au Nicaragua. Tout à coup, les situations d'urgence se sont multipliées. Nous qui n'avions aucune contrainte étatique, nous pouvions aller partout pendant cette époque de guerre froide, contrairement aux organisations dépendant des Nations Unies.
Est-ce à cette occasion que vous avez rencontré Bernard Kouchner ?
J-C.R. En fait, la première réunion du bureau à laquelle j'ai participé, c'est celle où il a été mis en minorité. C'était une ambiance soixante-huitarde où tout le monde s'engueulait. Puis l'organisation s'est structurée sous la direction de Claude Malhuret. Après un retour dans les hôpitaux parisiens, l'idée était de prolonger mon expérience en Tunisie. J'ai sauté sur l'occasion de partir à Djibouti où avait eu lieu un attentat dans un bar (en décembre 1977 deux grenades explosent au café « Palmier en zinc » faisant deux morts, dont un Français, et 31 blessés, ndlr). À l'époque, MSF n'était pas très connue dans le milieu médical et n'avait pas du tout l'aura qu'elle a acquise plus tard. Mon patron en neurologie à la Pitié Salpêtrière, François Lhermitte, n'en avait jamais entendu parler. Il m'a pris pour un zozo quand je suis allé lui dire où je partais en mission.
Se rendre à l'autre bout du monde au chevet des réfugiés, est-ce aussi une forme d'aventure ?
J-C. R. Je ne suis pas vraiment un aventurier, contrairement aux apparences. En réalité, le monde était moins dangereux à l'époque, tout était plus normé. Il y avait l'Est et l'Ouest, on savait à qui on avait affaire, les lignes de front étaient claires. L'engagement n'était pas forcément synonyme de risque. En tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. On le constate au moment des prises d'otages par exemple : on ne sait plus vraiment quels groupes sont impliqués : politiques, terroristes, mafieux ? L'aventure et le voyage, qui font partie de ma vie, ont été les sous-produits de l'exercice de la médecine telle que je la concevais. Si la guerre avait eu lieu en France, je serais resté. Je suis allé auprès des gens qui en avaient besoin, ce qui m'a conduit à voyager.
L'humanitaire est-il l'ultime forme d'engagement pour un soignant ?
J-C.R. Je pense que ça l'a été à une époque, qui a pris fin aujourd'hui. L'Europe a connu entre les années 1950 et 2000 une longue période de paix. La guerre, la violence, le terrorisme étaient loin. Et nous avons pu ainsi développer un rapport au monde fait de générosité et d'humanitaire. Le message étant : on ne vous oublie pas, on vous envoie des gens pour vous aider, mais tout ça ne nous concerne pas directement. De nos jours, la guerre est revenue sur notre sol, avec le 11 septembre 2001, les attentats de Charlie, du Bataclan, etc. Autrefois, on allait soigner les réfugiés à l'autre bout du monde. Désormais, ils sont sous le métro parisien à Stalingrad. De nos jours, il est tout à fait possible de s'engager sans s'expatrier.
Les ONG sont devenues un enjeu politique, au risque de se faire instrumentaliser par certains gouvernements ou factions. Faut-il aider les populations en danger à tout prix malgré les dérives possibles ?
J-C.R. La question de l'instrumentalisation de l'humanitaire par certains pays, on l'a constaté dès 1985 en Éthiopie. Le régime demandait de l'aide pour pouvoir déplacer des populations et les massacrer, et nous étions là pour faire le service après-vente de leurs crimes. C'est un thème que j'ai abordé dans Le Piège humanitaire (Pluriel, 1993). Depuis l'Ordre de Malte au Moyen Âge, la pratique humanitaire a évolué selon les époques. Dans l'Europe de la fin du xixe siècle, on a inscrit dans le droit la possibilité de porter secours aux plus vulnérables. Ensuite, il y a eu une période sans foi ni loi. Staline a par exemple refusé l'aide de la Croix-Rouge en Ukraine en 1932 pendant la grande famine (entre 2,5 et 5 millions de morts, ndlr). Puis sont arrivées les organisations des Nations Unies, les ONG américaines et européennes. Mais une nouvelle strate ne fait pas disparaître les autres : sur le terrain vous retrouvez tout le monde. Aujourd'hui, les ONG sont remises en question en raison de leurs origines occidentales et accusées de paternalisme. MSF a été attaquée récemment par certains de ses employés pour son « racisme constitutionnel ».
Vous avez été attaché culturel et de coopération au Brésil et ambassadeur de France au Sénégal. La diplomatie est-elle une autre manière de s'engager auprès des populations en difficulté ?
J-C.R. Une partie des responsables des grandes organisations humanitaires sont passés en politique et sont devenus ministres : Kouchner, Malhuret, Emmanuelli. C'est un pas que je n'ai pas franchi. Mais en suivant mes camarades dans leur parcours politique, j'ai occupé des responsabilités dans des cabinets ministériels puis des postes diplomatiques. C'est la marque d'une époque. L'humanitaire avait gagné une forme de prestige et de reconnaissance. On pensait qu'on aurait ainsi une diplomatie plus humaine. Je me suis retrouvé ambassadeur sur recommandation de Bernard Kouchner alors ministre des Affaires étrangères. Il y avait une volonté d'ouvrir le corps diplomatique, qui est jugé, non sans raison, un peu trop hermétique. En me désignant pour un poste en Afrique, ils pensaient rebattre les cartes du sujet souvent dénoncé de la Françafrique. Ça n'a pas très bien marché...
Pensiez-vous que vous pourriez avoir une influence dans ces pays grâce à vos expériences précédentes ?
J-C.R. Ma motivation principale était de transformer le mode de relation que nous avons avec ces pays, établir une forme de rapports avec les pouvoirs politiques de ces pays sur une base plus respectueuse. C'était un enjeu important. Au Sénégal, lors des élections présidentielles de 2007, j'ai fait en sorte que la France ne fausse pas le jeu démocratique. Je veux insister aussi sur la dimension consulaire de la diplomatie. Dans une ambassade, il y a toute une partie de l'activité qui n'est pas si différente de l'humanitaire.
Vous êtes aussi romancier. Peut-on porter la parole des populations fragiles à travers la littérature ?
J-C.R. C'est dangereux. La littérature à thèse a toujours une sorte de lourdeur. Pour moi, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est l'engagement qui m'a donné la matière de mes livres. À travers tout ce que j'avais vu, j'avais envie de transmettre des émotions, des situations, des paysages, des portraits en les transposant. Car quand on est médecin et qu'on écrit, il ne faut pas négliger le serment d'Hippocrate : on nous a fait jurer qu'on ne raconterait pas ce qu'on voit dans les foyers des patients. J'ai recours à la fiction pour me délivrer de ce serment et utiliser les choses dont j'ai été témoin. Bien sûr, mes livres correspondent à mes valeurs. Mais je me méfie beaucoup du caractère militant de la littérature. La littérature, c'est une moto qui doit avoir un gros moteur romanesque pour pouvoir transporter ses idées dans les sacoches. Ma priorité, c'est d'écrire des romans qui donnent envie de tourner les pages. En même temps, j'essaie de ne pas faire des livres gratuits. Dans Rouge Brésil, je raconte les premiers contacts entre Français et Brésiliens natifs. L'idée à l'époque était de civiliser ces « sauvages ». Dans le roman, ce sont plutôt les Français qui s'entre-tuent, préfigurant ainsi les guerres de religion.
Être un écrivain à succès qui accumule les prix et les distinctions, c'est une aide ou un frein à l'exercice de l'humanitaire ?
J-C.R. C'est clairement un frein. Il y a trois ans, un ami m'a trouvé une mission au Burundi, dans un hôpital de brousse tenu par des sœurs carmélites. J'y suis allé avec l'idée d'être anonyme, d'y travailler comme les autres. Évidemment, ils se sont précipités sur Internet pour taper mon nom et le lendemain mon anonymat n'existait plus. Avant, quand on voyageait, on arrivait à se sentir loin. Aujourd'hui, il y a toujours un satellite quelque part qui se souvient de vous. Quand on possède un peu de notoriété, on peut aider certaines causes, parrainer des organisations qui débutent. Mais pour agir soi-même, c'est plutôt un handicap.
Pourtant vous êtes resté ?
J-C.R. Oui, mais j'ai été traité comme un VIP. Ils étaient adorables : on ne me réveillait pas pour faire les césariennes ! En plus, l'endroit était un peu mal choisi car le Burundi est un pays qui possède un grand nombre de médecins très compétents. Je suis resté plusieurs mois même si ça n'avait plus du tout le goût de ce que j'avais connu dans le passé.
Vous avez été nommé en septembre 2020 président de la Fondation Sanofi Espoir. Quelle est sa mission et quels sont ses moyens ?
J-C.R. Je suis toujours attiré par les expériences nouvelles. Je connaissais l'action du côté des ONG et de la fonction publique avec la diplomatie. Là, il s'agissait d'aller voir du côté de l'entreprise. Quand Serge Weinberg (président du conseil d'administration de Sanofi, ndlr) m'a proposé de prendre la succession de Xavier Darcos (ancien ministre, qui a présidé la Fondation de 2015 à 2020, ndlr), j'ai accepté mais j'ai mis une condition. Je viens mais je vais d'abord regarder ce qui est fait et éventuellement transformer cette fondation. Je suis en train de remettre mes propositions en ce moment. La Fondation Sanofi Espoir a été créée il y a dix ans pour prolonger l'action de Sanofi dans le domaine du mécénat et pour venir en aide aux populations vulnérables. L'objet est large et volontairement ouvert. La Fondation s'est développée sur deux axes : les actions d'urgence et le long terme. Après l'explosion à Beyrouth (le 4 août 2020, ndlr), la Fondation et Sanofi ont envoyé d'importantes quantités de médicaments. Les programmes à long terme se déploient dans trois directions principales. À l'étranger, avec My Child Matters, sur les questions liées aux cancers pédiatriques et sur la santé maternelle et néonatale. En France, avec des actions autour de la santé des migrants. Nous avons par exemple travaillé avec Gynécologie Sans Frontières dans la jungle de Calais.
Quelles sont les inflexions que vous comptez apporter ?
J-C.R. Après la pandémie liée à la Covid-19, et si mes recommandations sont acceptées, nous devrions nous réorienter vers des programmes autour du rapport entre santé et environnement, un courant qui existe depuis le début des années 2000 et qu'on appelle le « One Health » (une seule santé). L'idée selon laquelle il existe un continuum entre santé humaine, santé animale et environnement. Tout cela est lié, comme le prouve de façon éclatante la pandémie actuelle. Par exemple, l'urbanisation sauvage de certains pays, particulièrement en Afrique, a modifié les habitudes alimentaires, avec pour conséquence une explosion du diabète et de l'obésité, le « double fardeau » (double burden).
Quels sont vos moyens financiers ?
J-C.R. C'est une fondation d'entreprise, avec un budget triennal d'environ 7 millions d'euros par an, et une répartition qui se fait sur appels à projets.
À propos de pandémie, vous écriviez dès 2007 dans Le Parfum d'Adam : « Il suffit de faire débuter l'épidémie en un endroit où elle trouvera les conditions favorables pour se développer. Ensuite, avec les transports aériens, elle se dispersera dans le monde entier ». En quoi ce type de crise globale affecte l'engagement humanitaire ?
J-C.R. La crise a placé les fonctions de santé au cœur des sociétés, alors qu'elles étaient considérées avant comme marginales. Ce qui a aussi été mis en évidence, c'est l'interpénétration forte de notre monde. Des événements considérés comme lointains peuvent arriver rapidement demain chez nous. La pandémie est aussi un accélérateur des inégalités entre systèmes de santé. Quand elle sera derrière nous, le bilan du nombre de morts sera le reflet de l'état des systèmes de santé dans les différents pays. Ce n'est pas tout à fait un hasard si le Royaume-Uni s'en sort mal.
Les fondations des laboratoires ont-elles un rôle encore plus stratégique durant ce genre de crise ?
J-C.R. Je dépasserais le cadre des fondations pharmaceutiques. Tout le mécénat d'entreprise doit mobiliser des fonds, car les autres sources de financement sont un peu en panne. Si les entreprises ont le souhait et les moyens de participer, il ne faut pas s'en priver. Le monde des fondations est très vivant, avec des statuts différents, qui mobilisent beaucoup d'argent, de bonne volonté et d'énergie. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai accepté de m'engager auprès d'un acteur industriel.
Comment parvient-on à concilier engagement humanitaire, activité professionnelle, littérature et vie privée ? Autrement dit, comment peut-on être Jean-Christophe Rufin ?
J-C.R. Je fonctionne par séquences. La littérature est pour moi une activité presque secrète. Je n'en parle pas et j'écris rapidement dans mon coin.
Quel est le titre de votre dernier roman ?
J-C.R. C'est le quatrième tome du cycle des « Énigmes d'Aurel le Consul » qui s'appelle La Princesse au petit moi et se déroule dans une principauté imaginaire d'Europe centrale. Il sort le 7 avril chez Flammarion.
___________________________________________________

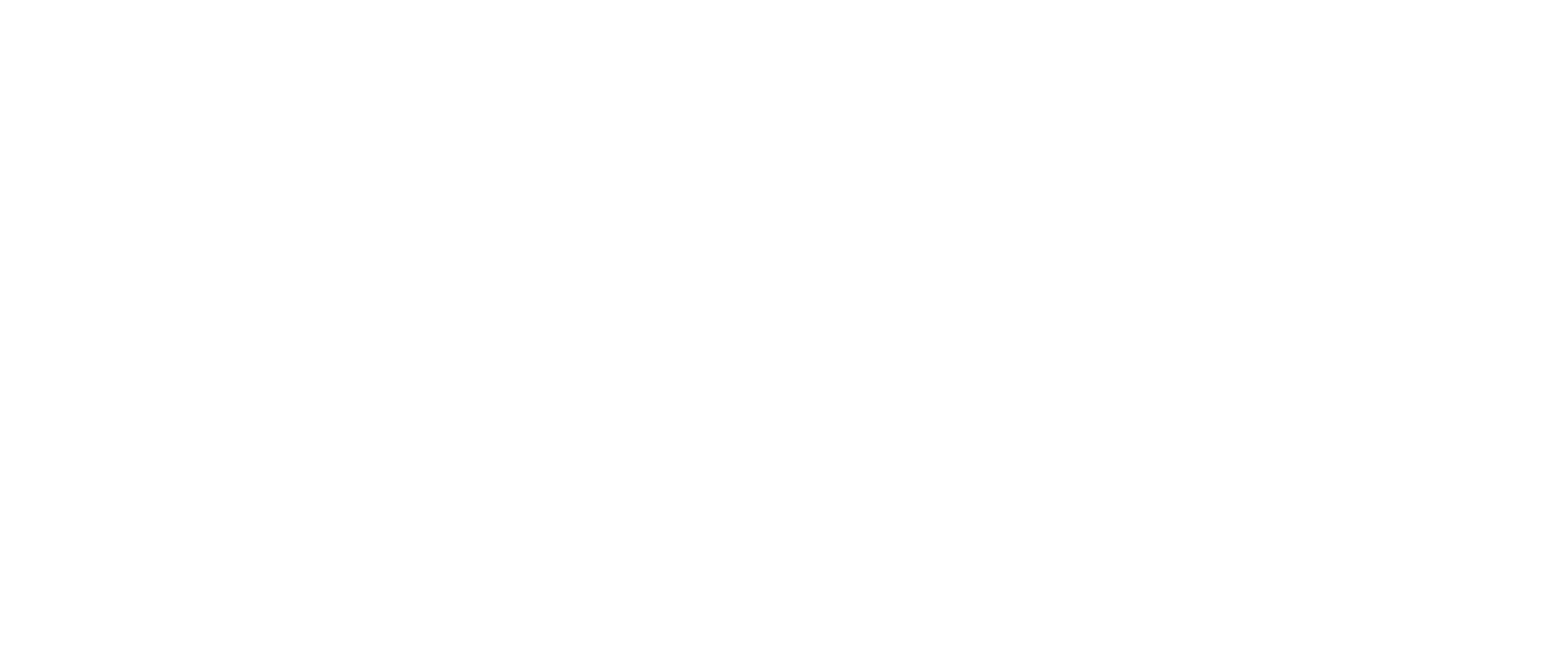


 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !