
« C'est une première mondiale », s'est félicitée Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, devant un parterre d'élus locaux et de représentants de l'Union européenne. Vendredi dernier, le groupe français a donné le coup d'envoi du projet Hypster, qui couple une production locale d'hydrogène à un système de stockage sur son site d'Etrez, situé au nord-ouest de Bourg-en-Bresse (Ain). « Ce projet pilote est précurseur car il ouvre la voie à l'industrialisation du stockage à grande échelle », a renchéri Charlotte Roule, la directrice générale de Storengy, la filiale d'Engie dédiée au stockage de gaz.
Une grande poche creusée dans du sel à 1.500 mètres de profondeur
Pourtant, sur place, cette première mondiale n'est pas très éloquente. Seule une tête de puits, qui ressemble à une grande valve d'environ quatre mètres de haut, est visible. Et pour cause, tout se passe... sous terre. Pour en voir plus, il faudrait se faufiler dans un tube d'une vingtaine de centimètres de diamètre. Une étroite canalisation descend, en effet, à 1.500 mètres de profondeur jusqu'à une poche de 8.000 mètres cubes, soit l'équivalent de la moitié d'un arc de triomphe. Celle-ci a été creusée dans une couche de sel par injection d'eau. C'est dans cette poche, en forme de grande cloche, qu'Engie a débuté il y a quelques jours l'injection d'hydrogène, cette toute petite molécule considérée comme clef pour la transition énergétique, afin de décarboner les usages qui ne peuvent être électrifiés, ou bien plus difficilement.
A termes, cet hydrogène pourrait alimenter des bus ou des bennes à ordures ou encore servir des industriels souhaitant verdir leurs procédés. L'intérêt d'y associer un système de stockage réside dans la possibilité de fournir de l'hydrogène en continu, même lorsque les électrolyseurs (les outils industriels permettant de produire de l'hydrogène grâce à un courant électrique qui casse la molécule d'eau) reliés à des énergies renouvelables s'arrêtent de fonctionner (naturellement la nuit lorsqu'il n'y a plus de lumière ou, volontairement, pour soulager le réseau électrique lorsqu'il y a une pointe de consommation, les matins et vers 19 heures les journées d'hiver).
Quelque 20.000 tonnes visées en 2030
« EZ 53 », - le nom de la cavité expérimentale -, est la plus petite du site d'Etrez, qui en compte vingt autres remplies de gaz. Cinq cavités supplémentaires sont actuellement « en saumure » c'est-à-dire en attente. Elles ont déjà été creusées et pourraient également accueillir de l'hydrogène. « Ce sont les plus grandes cavités salines du site. On peut y faire entrer 4 à 5 Arcs de Triomphe », illustre Charlotte Roule. A l'horizon 2030, Storengy ambitionne de stocker environ 20.000 tonnes d'hydrogène sur ce site. En parallèle, la filiale d'Engie prévoit de convertir deux autres cavités salines sur son site de Manosque (Bouches-du-Rhône) et étudie un projet en Alsace. D'autres initiatives pourraient aussi être menées en Allemagne et au Royaume-Uni où Storengy exploite également des cavités salines.
Ces volumes ne pourront toutefois être atteints que si la phase d'expérimentation d'Hypster permet de lever un certain nombre de doutes sur ce procédé de stockage, encore à ses balbutiements. Dans un premier temps, seules trois tonnes d'hydrogène seront ainsi injectées. S'en suivra une centaine de cycles de variation de pression de l'hydrogène pendant trois mois. Ce gaz ultra léger (environ 11 fois plus que l'air que nous respirons) sera ensuite soutiré et analysé. L'objectif est de comprendre comment il réagit avec la cavité saline, d'évaluer une potentielle dégradation et les traitements nécessaires à sa sortie (sans doute une étape de déshydratation).
De nombreux défis techniques
« L'hydrogène est un gaz aux propriétés chimiques très différentes de celles du méthane, relève Ludovic Leroy, ingénieur d'affaires et formateur dans les industries pétro-gazières. Lorsque vous compressez ce gaz, il est beaucoup plus chaud que le méthane. Par ailleurs, plus on injecte de l'hydrogène, plus la pression qui va s'exercer sur les parois de la cavité saline sera forte. Il faut s'assurer de ne pas l'abîmer, de ne pas créer des fissures », développe-t-il.
Le stockage d'hydrogène en cavité saline a déjà été testé au Texas et au Royaume-Uni, mais uniquement sur du très court terme ou en mode statique, c'est-à-dire sans cycle de flux entrants et sortants. L'expérimentation Hypster constitue donc une étape majeure. Reste que « chaque cavité a son propre microbiote, son propre microclimat », pointe Ludovic Leroy. Autrement dit, si le stockage d'hydrogène en cavité saline est pertinent sur un site, cela ne garantit pas qu'il le soit dans les mêmes conditions dans une autre zone géographique.
Teréga dans les starting-blocks
Engie n'est pas le seul à se lancer dans cette aventure. Même s'il est moins avancé, Teréga, l'autre opérateur français de stockage de gaz, s'y intéresse aussi de prêt. Il prévoit de développer des infrastructures de transport et de stockage d'hydrogène bas-carbone et renouvelable dans le cadre du projet Hysow.
« Nous visons une capacité de stockage d'hydrogène en cavité saline de 500 gigawattheure [soit environ 15.000 tonnes] à l'horizon 2030 et d'un térawattheure [soit environ 30.000 tonnes, ndlr] à l'horizon 2035", indique Antoine Charbonnier, responsable du pôle stratégie, innovation et développement de Teréga. »
Dans cette optique, l'entreprise, qui n'opère aujourd'hui que des stockages en systèmes aquifères, prévoit de créer une cavité saline en partenariat avec le groupe Salin. « Nous étudions en parallèle un projet de conversion de certains de nos sites de stockage en nappes aquifères dans un horizon plus lointain étant donné qu'ils vont jouer un rôle encore de longues années pour le stockage du méthane. Nous les utiliserons aussi pour stocker du biométhane », indique Antoine Charbonnier. La conversion de ces sites de stockage devrait toutefois être plus complexe, car les molécules d'hydrogène pourraient réagir avec la roche et former du sulfure d'hydrogène, un gaz neurotoxique.
Un enjeu majeur pour l'équilibre du réseau électrique
Au-delà de ces défis techniques, la question du modèle économique reste encore flanquée d'un grand point d'interrogation. Elle devra toutefois être résolue rapidement étant donnée l'importance que le stockage d'hydrogène devrait être amené à jouer pour assurer l'équilibre du système électrique tricolore à l'horizon 2035. Mercredi, Thomas Veyrenc, le directeur exécutif chargé du pôle stratégie de RTE, le gestionnaire du réseau des lignes à haute tension, a souligné « l'intérêt de connecter les électrolyseurs à des solutions de stockage d'hydrogène », lors de la présentation de son bilan prévisionnel actualisé.
« À long terme, le stockage en cavité saline apparaît comme un levier important pour limiter l'effet lors des pointes mais aussi pour optimiser le fonctionnement du système électrique : il permet de positionner la consommation [des électrolyseurs, ndlr] lors des périodes où la production renouvelable et nucléaire (...) est abondante et de l'éviter lorsque des centrales thermiques fossiles coûteuses sont nécessaires pour assurer l'équilibre du système électrique », détaille l'épais document. Dans son scénario de référence, RTE table ainsi sur une capacité de stockage de 12.000 tonnes d'hydrogène à l'horizon 2030 et de 80.000 tonnes en 2035.
« Cela permet des économies très substantielles sur le fonctionnement du réseau », a ajouté Thomas Veyrenc. Dans un autre rapport publié cet été, conjointement avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz, ces économies sont évaluées à 1,5 milliard d'euros par an.
Un angle mort de la stratégie nationale
Le défis est donc immense. D'autant plus que la France n'est pas la mieux placée. Jusqu'à présent, la stratégie nationale de l'hydrogène, qui consacre une enveloppe de 9 milliards d'euros au développement de la filière, ne prend pas en compte les infrastructures (transports et stockage). La donne pourrait toutefois changer lors de son actualisation, attendue dans les prochaines semaines après de multiples reports. Alors que le gouvernement britannique s'est déjà donné un cap dans ce domaine et que l'Allemagne entend mettre en service un réseau de transport d'hydrogène dès 2032, Engie redoute que la France se retrouve isolée. « Si nous n'investissons pas dès maintenant sur les infrastructures, elles ne seront pas au rendez-vous en 2030 », prévient Cécile Prévieu, directrice générale adjointe d'Engie, responsable des activités Infrastructures

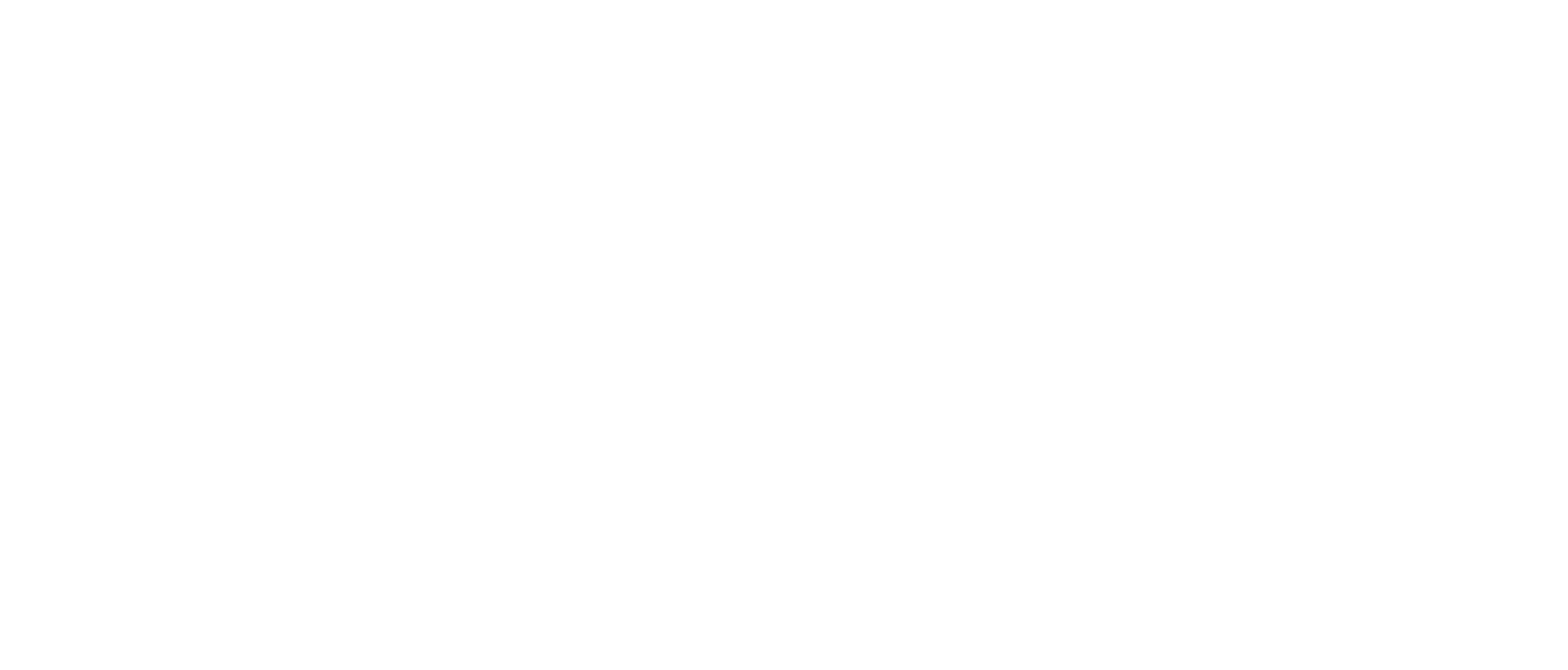

 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville

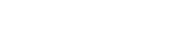
Sujets les + commentés