
Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour qu'on soit passé de « la fin de l'abondance » à « j'aime la bagnole, je l'adore » ? De cette contradiction qui n'est peut-être qu'apparente, Emmanuel Macron a fait le sel de notre semaine : commencée sous le signe de la planification écologique, elle s'achève sur le sentiment confus d'un quasi-retour à une économie administrée, avec (en caricaturant un peu, juste un peu) la mise sous tutelle des prix de l'essence et de l'électricité ou des marges producteurs-distributeurs. En fait d' « d'écologie à la française », on bascule vers une « écologie à la chinoise », s'inquiète un haut responsable patronal. Macron le libéral est rhabillé pour l'hiver en planificateur soviétique... Dans un pays qui vient de présenter un budget aux allures socialistes avec un record de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires et... le seul en Europe à être autant en déficit. Pas étonnant que la croissance française résiste à la récession, elle se shoote au quoi qu'il en coûte. Enfin se shootait, car c'est en train de s'inverser... lentement !
Outre les « 120.000 opérations de ventes de carburants à prix coûtant » vantées dans un communiqué de Matignon en mode panique face à la flambée des prix à la pompe et au fiasco de l'annonce de la remise en cause de la vente à perte, un autre épisode a agacé les acteurs économiques : il s'agit du nouveau concept de « marges négociées » inventé dans l'urgence pour forcer producteurs et distributeurs à rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs. La France vient en une semaine de nous faire vivre un remake du film « Retour vers le futur ». On revient au bon vieux temps du contrôle des prix institué en 1963 dans le cadre d'un plan de stabilisation ordonné par De Gaulle. Pour celles et ceux qui aiment l'histoire économique, le retour à la totale liberté des prix fut lente et progressive, de 1967 jusqu'à la libéralisation totale réalisé entre 1984 et 1986, c'est l'ironie de l'histoire, par Pierre Bérégovoy, le ministre des finances socialiste de François Mitterrand (et son célèbre directeur de cabinet Jean-Charles Naouri, devenu le patron de Rallye-Casino, mais ceci est une autre histoire).
Emmanuel Macron a des circonstances atténuantes : la peur de voir le prix la pompe passer au-dessus des 2 euros le litre et réveiller le Gilet Jaune qui est en chacun de nous et justifie parfaitement d'essayer de faire quelque chose. Mais les quelques centimes grappillés ne vont pas peser lourd dans la balance, pas plus que les 100 euros de chèque carburant redonné aux plus modestes, alors que plusieurs pays européens s'apprêtent eux à baisser les taxes sur l'essence, en Suède, en Espagne, au Portugal ou en Italie. Gageons que le feuilleton ne fait que commencer alors que le prix du baril de pétrole flambe à nouveau.
Soyons justes : Emmanuel Macron n'est pas le seul à aimer la bagnole. C'est aussi le cas de Joe Biden et de Donald Trump, les deux rivaux de la présidentielle de novembre 2024, qui ont soutenu les ouvriers des Big Three de l'automobile aux Etats-Unis en se rendant sur les piquets de grève. Notre président, qui a fait de la réindustrialisation de la France le mantra de son action, a bien raison de dire qu'il aime son industrie automobile et qu'il veut la défendre dans les temps difficiles de sa transition vers l'électrification du parc. Là n'est pas la question. Dans un pays comme la France, le train est aussi nécessaire que la voiture électrique restera indispensable pour nous déplacer. Le sujet qui risque de fâcher, c'est le prix de cette transformation, social et économique pour l'industrie et ses sous-traitants, financier pour l'acheteur de bagnole. Et là, force est de le constater, le plus grand flou règne encore sur la façon dont l'Etat veut en même temps défendre nos intérêts industriels, soutenir l'écologie sans pénaliser le pouvoir d'achat des automobilistes.
Comme elle a tenté d'arrêter les magnétoscopes japonais à Poitiers en 1982 par un blocus édicté par Laurent Fabius (qui n'a d'ailleurs pas sauvé avec le recul l'industrie électronique française), la France brandit l'arme du protectionnisme vert pour bloquer à la frontière les voitures électriques chinoises, en édictant des normes environnementales dures. Face à ce blocage, le géant chinois BYD, numéro 2 des constructeurs chinois de véhicules électriques, menace d'écarter la France de son projet d'implantation d'usine en Europe. La guerre commerciale menace.
De quelque côté que le gouvernement Borne se tourne, il se heurte à des injonctions contradictoires. Comment en même temps soutenir le pouvoir d'achat et la sobriété, terme qui a de fait complètement disparu. Forcer la baisse des prix de l'essence et du diesel tout en encourageant l'achat de voitures électriques. Freiner l'achat de chaudières à gaz sans les interdire, et ce alors que la création d'une filière française de pompes à chaleur électriques est un objectif encore lointain. Au congrès des Régions de France à Saint-Malo cette semaine, le président des Hauts-de-France, qui s'apprête à accueillir les quatre projets d'usines de batteries électriques géantes, a pointé d'autres contradictions, comme celle du ZAN (Zéro artificialisation nette) : « une gigafactory de batteries électriques ou une piste cyclable doivent-elle échapper au ZAN », a demandé Xavier Bertrand. On le voit bien, il est difficile de faire de la planification écologique dans un seul pays... Emmanuel Macron avait affirmé lors du discours de Marseille dans l'entre-deux-tours de la présidentielle que « le second quinquennat sera écologique ou ne sera pas », en piquant à Mélenchon son concept de planification. Il aurait pu ajouter que la transition écologique se fera par les territoires ou ne se fera pas.
Reste l'éléphant dans la pièce de la planification écologique : qui va payer quoi et combien ? On sait depuis le rapport Pisani qu'il faut investir 65 milliards d'euros supplémentaires par an, pour moitié par le secteur privé et pour moitié par l'Etat et les collectivités locales. Dans le projet de budget 2024 présenté cette semaine, l'Etat fait un réel et gros effort de 7 milliards, mais quand on décline le plan à l'échelle du pays, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de déficits.
Exemple, l'Etat ne propose que 700 millions aux régions pour son plan TER métropolitains porté de 10 à 13 projets, bonne nouvelle pour le rail. Mais les régions devront payer les rames. Quant aux 100 milliards d'euros réclamés par Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, on cherche encore d'où va venir l'argent. Le même flou règne sur le financement du programme de centrales nucléaires avec les 6 à 8 EPR2 annoncés par Emmanuel Macron à Belfort. L'Etat est pris à son propre piège : après avoir nommé Luc Rémont à la tête d'EDF pour lui demander de rebâtir un plan industriel pour l'électricien, Emmanuel Macron lui met la pression pour freiner ses appétits sur la hausse des tarifs de l'électricité au nom de la compétitivité et du pouvoir d'achat. En annonçant que la France veut reprendre le contrôle des prix de l'électricité (qui viennent de subir une augmentation de 10% en août), le chef de l'Etat affiche la schizophrénie du pouvoir qui doit réussir la transition énergétique en pleine reprise de l'inflation. Pourtant, le prix de l'électricité pour les ménages est encore très loin du prix du diesel à la pompe. Mais pour combien de temps.

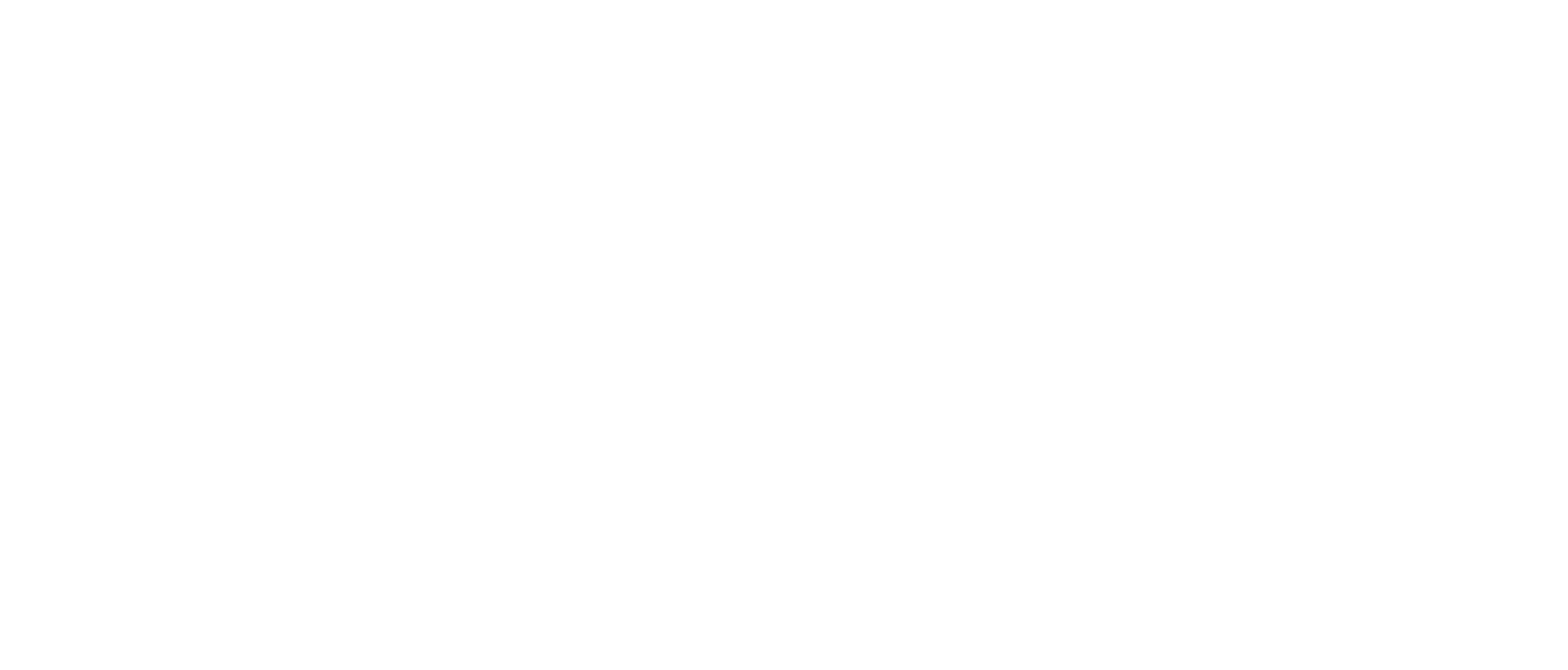

 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville

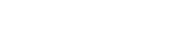
Sujets les + commentés