
« Si nous ne sommes pas capables d'embrasser la question de la redistribution. C'est bonnets rouges et gilets jaunes mais puissance mille ». Avec ces mots, l'essayiste Antoine Buéno n'a pas hésité à jeter le pavé dans la mare ce mardi, au cours d'un débat sur l'avenir des transports lors de La Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef à l'hippodrome de Longchamps. Face à Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports, Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis, ou encore Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, l'auteur de L'effondrement (du monde) n'aura (probablement) pas lieu, a mis en garde contre l'impact que pourrait avoir la transition écologique et énergétique sur le plan social.
Parti d'une réflexion sur les moyens de réguler, voire de modérer la demande de transport pour faire face à l'urgence climatique, notamment par le prix plutôt que par la réglementation, Antoine Buéno a déclaré : « Vous demandiez comment on fait pour faire la transition. C'est simple, il faut que les transports polluants soient chers. Toute la question est de savoir comment faire pour qu'ils soient plus chers que les modes non polluants, sachant que ces modes non polluants vont aussi demander des investissements. Cette situation va entraîner mécaniquement un renchérissement de tous les transports. Ensuite, il faut voir comment accompagner ça socialement. Il ne peut pas y avoir de transition, en particulier dans les transports, sans redistribution sociale massive. »
« Il faut l'assumer d'un point de vue politique, et être très clair sur le fait que cette transition - et j'aime bien ce terme-là du président de la République - c'est la fin de l'abondance », a poursuivi Antoine Buéno, élargissant sa réflexion à un monde où « l'énergie sera plus chère et donc tout sera plus cher », d'où une croissance plus faible, sans comparaison avec les taux connus depuis la révolution industrielle. Un nouveau paradigme qui pose donc la question de la redistribution, sans quoi la colère sociale se fera de nouveau entendre.
« Les biocarburants ou les carburants de synthèse, aujourd'hui en phase de développement et très peu matures, sont des produits rares et chers. Cela peut effectivement se traduire par l'augmentation des prix du transport qui va elle-même se traduire par l'augmentation des produits transportés », Claire Martin, vice-présidente développement durable CMA-CGM (actionnaire unique de La Tribune, NDLR)
Mesures impopulaires
L'essayiste réagissait, entre autres, aux propos du patron des aéroports parisiens, Augustin de Romanet, favorable à une certaine modération dans les usages de l'avion et convaincu que cela se fera naturellement par l'augmentation du prix des billets inhérente à la transition énergétique qui s'amorce : « En obligeant, comme l'a fait le ministre (Clément Beaune), les énergéticiens à se prendre la peau du cou et en obligeant les compagnies aériennes à intégrer des carburants durables qui coûtent plus cher, on va augmenter le prix de l'avion et introduire une certaine régulation. Cela n'est pas très populaire que de dire que l'on est partisan de l'augmentation du prix de l'avion. En revanche, je crois que c'est responsable pour faire une forme d'auto-limitation. »
Mais la question dépasse assez largement le domaine de l'aérien pour toucher l'ensemble des modes de transport. Et notamment ceux du quotidien, à l'image du prix des carburants routiers, toujours très sensible puisqu'il était à l'origine du mouvement des gilets jaunes. C'est en effet la hausse d'une taxe sur les carburants qui avait mis le feu aux poudres à l'automne 2018, même si les raisons de la colère étaient bien plus profondes. La question est d'autant plus délicate que, comme l'a analysé Marie-Ange Debon, « si nous regardons d'un point de vue social, sociologique, la mobilité est un droit des droits, C'est le droit à être éduqué, à avoir des loisirs. Si vous n'avez pas la mobilité, vous ne pouvez pas pleinement sortir de votre environnement, sortir de votre milieu, sortir de votre pays. »
L'usager plutôt que le contribuable et les entreprises
Malgré ce souvenir douloureux du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, Clément Beaune n'a pas esquivé cette question du prix. Pour lui, celle-ci doit se poser pour le financement de la transition écologique, car « tout ça a un coût, un coût public et privé ». « Quand nous avons besoin de réinvestir massivement dans nos transports, il y a deux modes de financement, à savoir l'usager et le contribuable. Je n'ai pas trouvé de recette magique autre. Je l'assume parfaitement et je le dis sans aucune démagogie : pour la route comme pour le train et les autres modes de transport, il faut que l'usager en paye une partie. C'est plus juste et plus vertueux. Sur l'exemple de la route, nous avons eu des débats un peu surréalistes dans l'hémicycle il y a quelques semaines encore, où beaucoup disaient qu'il fallait lever les barrières de péage aux autoroutes pour l'été. Démagogie », a-t-il développé par la suite.
Il a ainsi rappelé son opposition aux politiques de gratuité : « Nous n'allons pas faire payer au contribuable qui utilise le train tous les jours, l'usage de la route. De même dans le transport public [...], nous n'allons certainement pas tout faire peser sur le contribuable, notamment sur le contribuable entreprise ». Parant à d'éventuelles critiques, il a tout de même rappelé que les tarifs devaient rester raisonnables, notamment pour les transports en commun.
Un moyen de transformer les usages
Dans cette régulation par le prix, Clément Beaune voit aussi un moyen de faire évoluer les usages, question qu'il juge fondamentale. « Si nous voulons faire à la fois un peu de report modal et surtout de l'investissement, de la transition écologique, et bien oui, cela passe principalement par le prix. C'est bien documenté en théorie économique. Et le prix, disons-le de manière directe, c'est en partie la taxe. Je veux le faire de manière proportionnée, raisonnable, etc (sic) », a déclaré le ministre, assumant pleinement ses récentes prises de position sur une taxation renforcée des billets d'avion et les sociétés d'autoroutes au profit de la transition écologique et du train.
Un discours qui peut avoir du mal à passer auprès de la population alors que les critiques sur les prix élevés du train ont fusé tout l'été. Clément Beaune s'est d'ailleurs posé comme défenseur des prix de la SNCF, rappelant que « le train est structurellement plus cher que l'avion » en raison de ses coûts d'infrastructures avant d'ajouter « parce que le débat sur les prix du train est un débat très important de pouvoir d'achat, mais c'est en France qu'on a le reste à charge le moins élevé en moyenne, sur le train tout confondu, du métro au TGV par rapport à nos autres voisins européens ». Il a ainsi rappelé par la même occasion que le ferroviaire était aujourd'hui déjà « massivement subventionné ».
« Le reste à charge est quelque chose qui est très mal connu. Les transports publics sont très largement subventionnés et il faut vraiment le mentionner. Et il ne faut pas oublier dans la pédagogie que le coût de détention d'une voiture est lui aussi très mal connu. C'est plus de 500 euros par mois. Ce n'est donc pas un moyen de transport plus économique que le transport collectif, au contraire », Marie-Ange Debon, présidente-directrice générale de Keolis
Prise de conscience des coûts
Sur la nécessité de mettre les usagers à contribution, Christelle Morançais, présidente de la région Pays-de-la-Loire, s'est voulu encore plus claire : « J'assume totalement, en région Pays-de-la-Loire, l'augmentation des coûts. Aujourd'hui, dans les transports scolaires, je passe de 110 à 150 euros, sachant que le coût réel pour la région, c'est 950 euros et qui va passer à 1.250 euros. Il faut avoir aussi une prise de conscience de combien coûte aujourd'hui les transports. » D'autant qu'elle fait du prix l'un des principaux leviers de financement de la mobilité, avec la mise en concurrence.
Pourtant, la présidente des Pays-de-la-Loire a appelé à faire « attention aux inégalités » et à ne pas « opposer les territoires entre urbain et rural, entre les hommes et les femmes », rappelant que « quand on est sur un territoire rural, comme c'est le cas dans la région des Pays de la Loire, vous n'avez pas de ligne ferroviaire ». Elle a ainsi prôné une approche différenciée selon les territoires, notamment sur la place de la voiture.

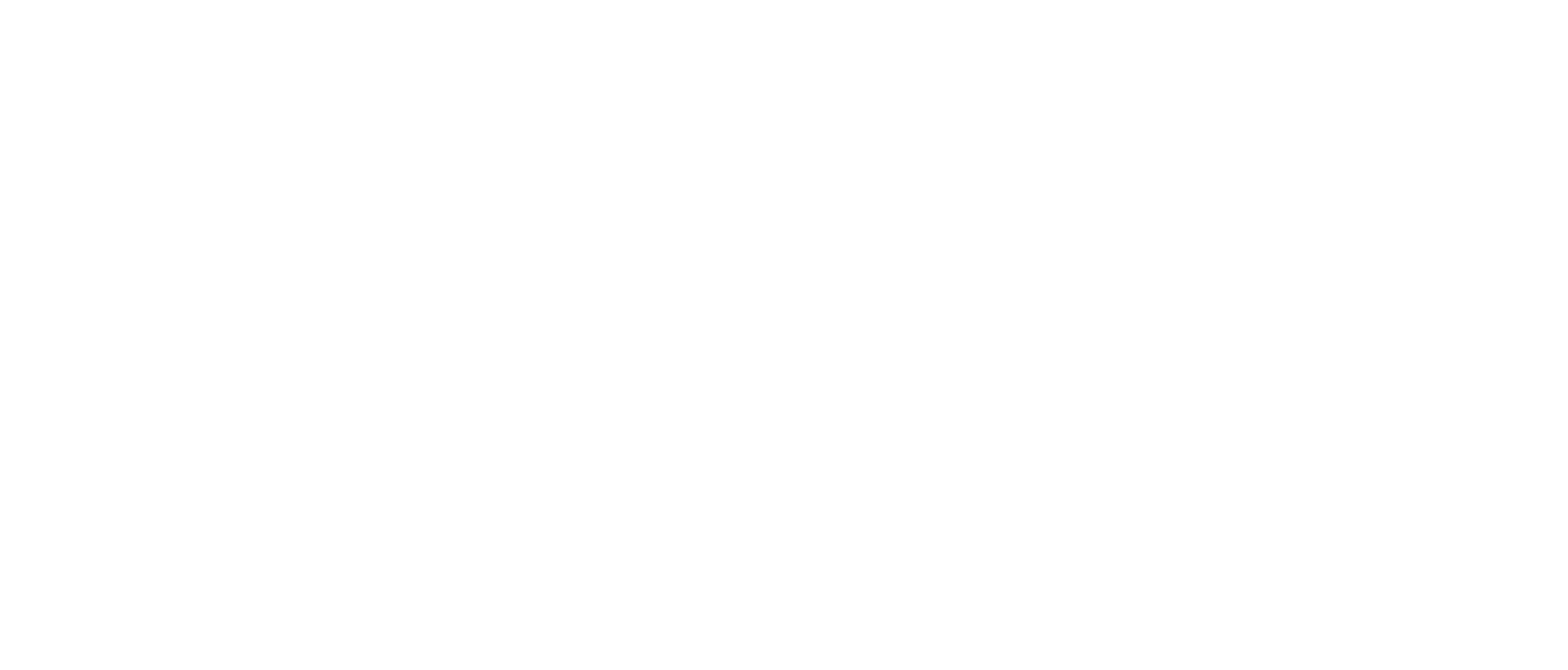

 Les « dark stores » sont bien des entrepôts, le Conseil d'Etat donne raison au gouvernement
Les « dark stores » sont bien des entrepôts, le Conseil d'Etat donne raison au gouvernement

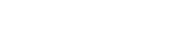
Sujets les + commentés