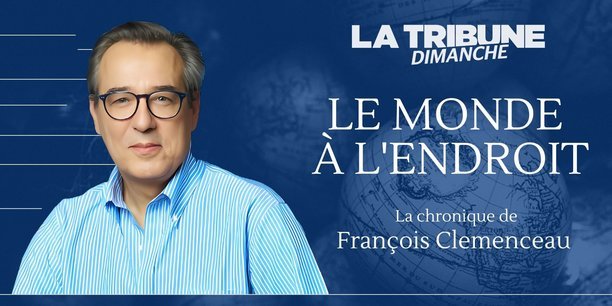
Bien sûr, personne n'ira suspecter le Premier ministre actuel de Sa Majesté d'être déloyal envers son roi. Mais il s'agit ici d'évoquer les rébellions tous azimuts sur l'échiquier politique au pays de la série culte The Crown. Depuis le départ de David Cameron en 2016, après son référendum raté sur le Brexit, Rishi Sunak est déjà le quatrième patron des Tories à entrer au 10 Downing Street. À la tête du Foreign Office, interlocuteur clé des Européens et des partenaires du Royaume-Uni, sept ministres des Affaires étrangères se sont succédé à ce poste ces sept dernières années ! Qui se souvient du nom des prédécesseurs de David Cameron, qui vient d'y être nommé à la surprise générale ?
La moitié des ministres ont changé d'affectation depuis un an
Depuis que Sunak est arrivé au pouvoir, plus de la moitié de ses ministres ont changé d'affectation. Fut un temps où les titulaires de portefeuille démissionnaient à tout bout de champ en raison de scandales souvent dus à leur vie privée. Mais aujourd'hui au Parti conservateur, démission est plus souvent synonyme de trahison. Entre ultralibéraux prêts au schisme pour le moindre allègement d'impôts et centristes d'une droite plus sociale, bien au fait des effets pervers du Brexit, le clivage est vertigineux. Entre proeuropéens conscients qu'on ne peut plus rester totalement une île et brexiteurs jusqu'au-boutistes cherchant désespérément des alliés à l'autre bout de ce qui reste du Commonwealth, la faille est permanente. Entre partisans d'une immigration zéro qui veulent sous-traiter les demandeurs d'asile au Rwanda et pragmatiques soucieux des prérogatives de la Cour européenne des droits de l'homme, le fossé se creuse chaque jour davantage. Sunak doit en fait composer avec les ultras de son parti qui n'entendent rien lâcher après treize ans au pouvoir. Pourtant, s'ils devaient se rendre aux urnes demain, les sujets du roi désigneraient la gauche pour gouverner le pays, avec 20 points d'avance...
Le Parti travailliste divisé
Les divisions au sein du Parti travailliste sont également des plus visibles. Beaucoup pensaient que l'éviction de Jeremy Corbyn permettrait enfin au Labour de faire la synthèse. Avec d'un côté socialistes, brexiteurs et wokistes accusés d'antisémitisme. Et de l'autre sociaux-libéraux pragmatiques et pro-Israël, héritiers de la triangulation à la Tony Blair. Depuis les pogroms barbares perpétrés le 7 octobre par le Hamas dans les kibboutz frontaliers de Gaza, le nouveau patron du parti, l'avocat Keir Starmer a choisi de coller à la ligne britannique de soutien total à Israël, mais pas sous prétexte que son épouse et ses enfants sont juifs. Comment justifie-t-il son refus d'appeler à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ? « J'agis et je parle comme si j'étais au gouvernement », plaide-t-il, faisant preuve à cet égard d'une conduite risquée sur le plan électoral mais qu'il juge « responsable ». Depuis que l'armée israélienne est entrée dans Gaza et que les manifestations propalestiniennes se succèdent tous les samedis dans les grandes villes du pays où les communautés pakistanaise, indienne et bangladaise sont importantes, dix membres du shadow cabinet de Starmer s'opposent à lui et plus de cinquante élus du Labour menacent d'indiscipline de vote aux Communes.
À cela s'ajoute la question écossaise. Le Parti national écossais au pouvoir à Édimbourg a présenté vendredi ses objectifs de ralliement à l'Union européenne dans le cas où l'indépendance serait acquise à la suite d'un référendum. Bien que la Cour suprême britannique ait déclaré tout nouveau scrutin de la sorte illégal sans autorisation de Londres, le Premier ministre écossais, Humza Yousaf, estime qu'une victoire haut la main de son parti aux prochaines élections lui donnerait mandat pour entamer le découplage d'avec le royaume. Yousaf - dont les beaux-parents sont d'origine palestinienne et ont pu s'échapper de l'enfer de Gaza - ainsi que le chef du parti travailliste écossais, lui aussi d'origine pakistanaise, sont hostiles à la démarche de Keir Starmer. Qu'il s'agisse de sa solidarité inconditionnelle avec Israël ou de son refus de cautionner un scrutin référendaire en faveur de l'indépendance de l'Écosse.
C'est ce royaume aux partis désunis que le nouveau ministre des Affaires étrangères, David Cameron, va devoir représenter sur la scène internationale en attendant les élections de 2024. Sa première décision a été de se rendre à Kiev et à Odessa. Lorsqu'il était Premier ministre, c'est lui qui avait supervisé le programme de formation des forces spéciales ukrainiennes par le SAS britannique. Au-delà du soutien sans faille à l'Ukraine, c'est bien ce sujet de consensus total à domicile que Cameron a voulu afficher à l'extérieur, comme s'il n'y en avait plus beaucoup d'autres.

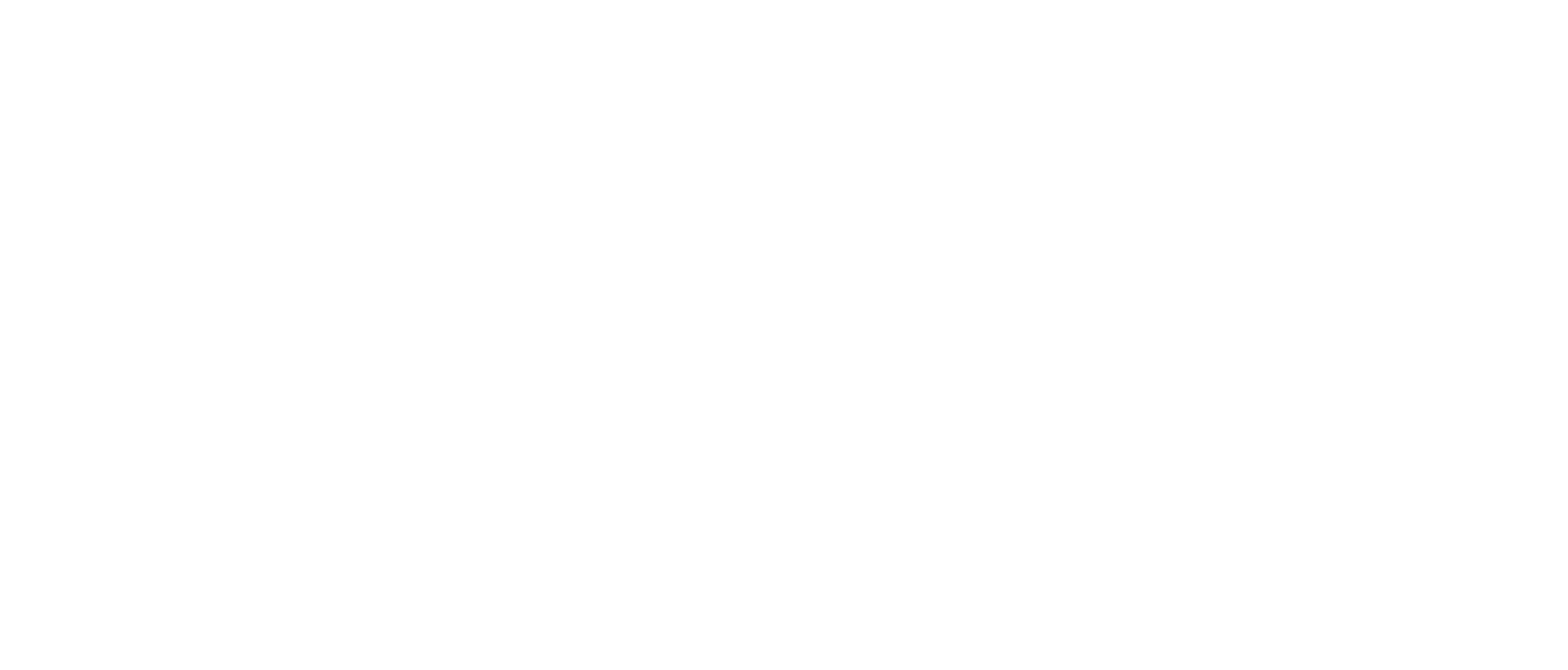
 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville

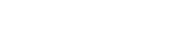
Sujets les + commentés