
Le procès de l'accident du vol Rio-Paris a connu quelques coups d'éclats ces derniers jours, avec des questions de fond qui ressurgissent régulièrement, sans réellement trouver de réponse. Parmi ces questions, celle de l'influence des directeurs de vol pour expliquer les manœuvres difficilement compréhensibles effectuées par le pilote, revient une nouvelle fois dans les débats, à l'occasion de cette quatrième semaine d'audience.
Certains experts estiment qu'il y a eu un impact, ou du moins une perturbation sur le comportement de l'équipage. Une hypothèse que le Bureau d'enquête et d'analyse (BEA) ne tranche pas véritablement, en parlant plutôt de « probabilité ». Du côté des témoins appelés par Airbus, l'absence de corrélation est catégorique. Et cet avis est partagé au-delà d'Airbus, notamment par les experts du dernier collège mandaté par la justice. Ces derniers l'ont réaffirmé devant le tribunal ce lundi, même si l'un d'entre eux a tenu à pondérer son analyse, écornant au passage cette défense, jusque-là solide.
Plusieurs automatismes ciblés
Dans un tribunal où le 737 MAX et son système automatique anti-décrochage MCAS sont cités régulièrement - avec plus ou moins de pertinence - la question d'un automatisme ayant pu induire les pilotes en erreur est prégnante. Dans cette catégorie des automatismes, possiblement trompeurs, plusieurs sont cités.
D'abord, il y a l'alarme d'écart d'altitude (ou C-Chord) qui sert à signaler une différence entre la position de l'avion et la valeur sélectionnée par les pilotes dans l'ordinateur de gestion de vol (FMS). Elle s'est déclenchée à bord de l'AF447 en raison d'une baisse d'altitude fictive de 300 pieds environ (90 m) en raison de la perte des indications de vitesse, qui permettent de corriger l'altimètre).
Ensuite, arrive le message « Nav ADR Disagree » qui signale un problème dans les données anémométriques sur le système de surveillance électronique centralisée de l'avion (ECAM). Ce message n'est apparu que 2 minutes et 39 secondes après le givrage des sondes du Rio-Paris. Enfin viennent les directeurs de vol, conçus pour aider le pilote à garder une trajectoire donnée, qui calculent et affichent des tendances à suivre sur les plans longitudinal et horizontal.
A l'inverse du pilote automatique et de l'auto-poussée, les directeurs de vol ne se désengagent pas automatiquement au moment de la perte d'indications de vitesse (IAS). Lors de l'accident, en 2009, les procédures d'IAS douteuse d'Air France comme d'Airbus demandaient qu'ils soient désengagés par l'équipage. Ce qui ne sera pas fait à bord de l'AF 447, les pilotes n'ayant pas suivi la moindre procédure.
En l'absence d'indications de vitesse valides pendant 30 secondes à une minute, selon les sondes, les barres de tendance qui transmettent les indications à suivre au pilote « ont disparu puis réapparu à plusieurs reprises en changeant plusieurs fois de mode », selon les constats du BEA. Elles ont ainsi été visibles par le pilote en fonction pendant 4, puis 10, puis 1 et enfin 53 secondes dans les deux minutes suivant la perte d'indications de vitesse.
Un changement de mode furtif
Si les premières apparitions furtives de quelques secondes n'ont été guère pertinentes, celle de 10 secondes, et surtout celle de 53 secondes, ont potentiellement eu un impact. Si celui-ci a pu être trompeur pour le pilote aux commandes (dit aussi « en fonction »), c'est que les directeurs de vol ont changé de mode sans que l'équipage ne s'en rende compte.
Empêtrés dans les alarmes, et sortant complètement de la trajectoire, les pilotes n'ont pas vu le changement d'indication sur leurs écrans de vol principaux (PFD), où la mention « ALT CRZ » a été remplacée par « V/S » : configurés en capture d'altitude pendant la phase croisière, les directeurs de vols n'ont pas pu se recaler sur l'altitude 35.000 pieds initialement sélectionnée en raison des importantes actions à cabrer du pilote suite à la déconnexion du pilote automatique, qui ont emmené l'avion à plus de 37.000 pieds. Ils sont donc passés en mode de suivi de vitesse verticale, ce qui correspond à l'attitude de l'avion au moment où ils sont réapparus. D'abord calés sur une vitesse verticale de 6.000 pieds/min pendant la phase de 10 secondes, les directeurs de vol ont ensuite visé 1.400 pieds/min lors de celle de 53 secondes.
La barre de tendance longitudinale a ainsi indiqué « un léger ordre à cabrer » selon les termes du BEA puis, au fur et à mesure des actions du pilote sur les commandes, brièvement a piqué et, à nouveau, a cabré. La question se pose donc de savoir si la barre de tendance longitudinale a influencé le pilote en fonction au vu de ses actions en tangage, incohérentes avec la situation.
C'est une hypothèse qu'indique d'ailleurs le BEA : « L'influence du directeur de vol semble donc probable. Le PF a pu être tenté de le suivre sans valider les informations présentées. » Les enquêteurs ont établi que « même s'il n'est pas certain que l'équipage ait suivi les ordres du directeur de vol alors que l'alarme de décrochage était active, les ordres des barres de tendance étaient contradictoires avec les actions à appliquer dans cette situation et ont donc pu perturber l'équipage ». Ou encore que « la concurrence des informations des directeurs avec l'alarme Stall (décrochage) a pu perturber la crédibilité des actions à apporter en réponse à l'alarme ».
Course après les barres de tendance
C'est un axe également retenu par le 1er collège d'experts mandaté par l'instruction entre 2009 et 2012. Lors de son témoignage au procès, Alain de Valence de Minardiere, ancien pilote, indique tout d'abord le retour durable des barres de tendance, une quarantaine de secondes après le givrage des sondes, comme une bonne nouvelle : cela signifie que toute la chaîne d'indication de vitesse est à nouveau fonctionnelle. Il tempère par la suite : lors de leur réapparition les barres de tendance sont logiquement centrées, ce qui peut donner « une fausse impression de confiance ». Impression d'autant plus faussée que l'équipage n'a pas pris en compte le changement de mode des directeurs de vol, et que la situation est déjà catastrophique avec une assiette et une incidence de l'ordre de 5 degrés et une alarme de décrochage qui s'apprête à résonner de façon continue pendant 54 secondes.
Alain de Valence de Minardiere estime ensuite que le pilote, qui continue ses fortes actions à cabrer jusqu'à amener l'avion à une assiette et une incidence de 16° en quelques secondes, « court après ses barres de tendance » sans se rendre compte du décrochage de l'avion malgré l'alarme qui retentit et de la perte d'altitude qui s'amorce. L'expert estime ainsi qu'il y a certaines cohérences entre les actions du pilote aux commandes et les barres de tendance.
Expert ingénieur au sein du même collège, Hubert Arnould est plus mesuré rappelant que l'équipage n'a pas su regarder les instruments les plus basiques, parfaitement fonctionnels, à leur disposition : « Les barres de tendance ont pu induire en erreur l'équipage, même si l'horizon artificiel montrait bien que l'avion avait le nez vers le haut. » Et leur collègue, Michel Beyris, d'ajouter que le changement de mode est facilement identifiable sur l'écran principal de vol, à condition d'être en mesure de le voir au vu de la charge de travail et du stress de l'équipage de l'AF447 à ce moment-là. Si cela avait été le cas, notamment par le pilote non en fonction chargé de surveiller ce type d'élément, les pilotes auraient alors dû reprogrammer les directeurs de vol pour qu'ils affichent à nouveau des ordres pertinents.
Un constat loin d'être unanime
Etienne Lichtenberger, directeur de la sécurité et de la qualité aux Opérations aériennes d'Air France jusqu'en mars 2009 puis nommé directeur corporate de la sécurité trois mois avant le drame, lui ne s'explique pas pourquoi le pilote aux commandes (ou en fonction) applique à nouveau des actions à cabrer après avoir stabilisé un temps l'assiette à 6 degrés. Mais il est convaincu qu'il a agit en fonction de quelque chose.
Selon son témoignage, il n'est pas possible qu'un pilote d'Air France prenne 12° d'assiette (puis 16°) sans raison. Il ne va pourtant pas citer les barres de tendances, jugeant que les actions à cabrer sont dues à une représentation inversée de la situation, avec une fausse perception de survitesse. Et de fait, si le pilote aux commandes a tiré sur le manche pendant 12 secondes de suite, de façon consciente, au-delà de l'effet de surprise initial, c'est dans le but assumé de réduire cet excès de vitesse.
Du côté d'Airbus, Marc Parisis, responsable du soutien aux compagnies aériennes au moment des faits et resté au sein du constructeur jusqu'à sa retraite l'an dernier, est clair sur le sujet. Lors de son témoignage, il évoque de lui-même le sujet des barres de tendances, qui a questionné pendant longtemps les équipes d'Airbus afin de comprendre « ce pilotage assez désordonné en assiette ». Et s'il juge les premières analyses « en photo » peu concluantes, avec, un coup une action qui semble corrélé aux barres de tendances et un coup non ; il estime que les analyses dynamiques menées dans un deuxième temps sont sans appel.
Citant le rapport de la deuxième et dernière contre-expertise - demandée par la justice en 2017 suite à l'invalidation de la première deux ans auparavant - Marc Parisis déclare qu'il n'y a eu « clairement aucune corrélation » sur les 47 premières secondes et que « l'on ne peut pas conclure » sur les 6 dernières secondes. Il estime ainsi que les pilotes n'ont pas eu d'objectifs de pilotage à partir du passage en pilotage manuel, du moins en assiette, et que rien ne semble pouvoir justifier les actions à cabrer longues et répétitives qui ont conduit l'avion jusqu'au décrochage.
Une absence de corrélation confirmée ce lundi par Gilles Le Barzic, Patrick Le Pastor et Jean-Yves Grau, le premier rappelant que de toute façon l'avion est déjà en décrochage et que l'objectif affiché par la barre de tendance longitudinale est alors inatteignable. La première contre-expertise, celle invalidée, est d'ailleurs sur la même ligne. Elle établit également que le pilote en fonction n'a pas tenu compte des directeurs de vol, que ce soit lors des premières réapparitions des barres de tendance ou par la suite, lorsque celles-ci se sont maintenues pendant 53 secondes.
Des doutes subsistent
Pourtant, Gilles Le Barzic a entrouvert une légère brèche dans cette affirmation. Après avoir rappelé que le réengagement automatique des barres de tendance était problématique et pouvait conduire celles-ci à donner des « ordres complètement aberrants », il a émis un doute : « nous avons écrit dans le rapport qu'il n'y avait pas de corrélation. Je suis plus pondéré, je ne sais pas vous dire si le pilote à chercher à suivre ou non » les ordres des directeurs de vol. Il rétropédale quelque peu quelques heures plus tard, en précisant que ces doutes portent surtout sur la fin de cette fameuse séquence de 53 secondes, où le pilote maintient une action à cabrer en continu, pendant que la barre de tendance indique un important ordre à cabrer.
Que l'équipage ait suivi ou non les indications des directeurs de vol, le BEA a fait des recommandations suite à l'accident du vol Rio-Paris pour que ce type de situation ne survienne pas à nouveau. Airbus et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ont modifié en conséquence certaines logiques de fonctionnement des directeurs de vol sur l'ensemble de sa flotte du constructeur européen. Ceux-ci se désengagent désormais automatiquement et ne se réenclenchent pas sans une action du pilote.

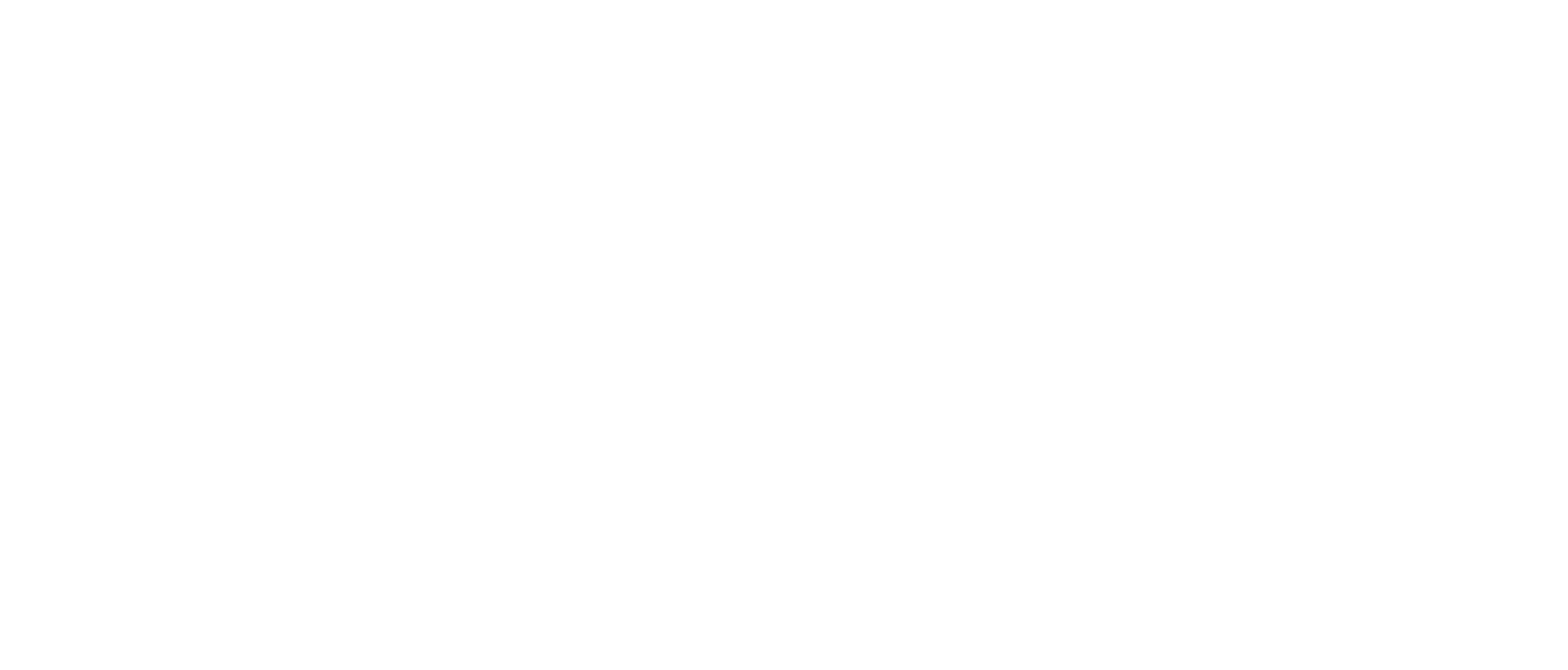

 Les « dark stores » sont bien des entrepôts, le Conseil d'Etat donne raison au gouvernement
Les « dark stores » sont bien des entrepôts, le Conseil d'Etat donne raison au gouvernement

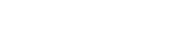
Sujets les + commentés