
Obligation de vrac dans les commerces, possibilité pour les régions de créer une écotaxe, instauration de « zones à faibles émissions », interdiction de vols aériens, éradication à terme des passoires thermiques, division par deux du rythme d'artificialisation des sols, expérimentation d'un menu végétarien quotidien, création du délit d'«écocide »... Au lendemain de manifestations au cours desquelles citoyens et élus ont demandé « une vraie loi climat », le projet de loi « Climat et Résilience » est arrivé ce lundi 29 mars dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
« Les mots ont un sens. Ce texte n'est pas une trahison, mais le fruit de dix-sept mois d'échanges avec la Convention citoyenne pour le climat » réagit, pour La Tribune, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable.
« Tout n'a pas vocation à être dans la loi. Attention aux jugements ! » ajoute Olivia Grégoire.
Porteuse des deux premiers chapitres du titre II « Produire et travailler », l'ex-députée (LREM) de la 12ème circonscription de Paris s'agace par exemple de la note de 6,1/10 attribuée à la réforme de l'article 1er de la Constitution pour y introduire les notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le changement climatique.
« Le jugement est assez exigeant mais la mesure la mieux notée par les citoyens concernant l'intégration dans la constitution de la notion de réchauffement climatique, reprise intégralement, obtient 6,1. Donc il faut rendre le rendre relatif », regrette Olivia Grégoire, alors que le président Macron a annoncé, en décembre 2020, la tenue d'un référendum sur la question.
Verdir les marchés publics
Concernant la commande publique, par exemple, la secrétaire d'Etat ne manque pas de le rappeler : l'article 15 portant sur le verdissement de celle-ci « va plus loin et plus vite » que ce que proposait la Convention Citoyenne pour le Climat.
« Les 150 citoyens demandaient à renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics d'ici à 2030. Nous avons avancé l'échéance à cinq ans seulement. Alors même que l'on nous accuse de reculer », signale-t-elle.
« C'est l'exception qui confirme la règle », avait rétorqué à ce sujet la députée écologiste des Deux-Sèvres, Delphine Batho (GE), lors des débats en commission.
Concrètement, le texte propose d'abandonner le critère unique du prix pour l'achat public, de manière à privilégier celui du coût, plus large. Aujourd'hui, aucune disposition n'impose en amont que les préoccupations environnementales se traduisent dans la procédure d'attribution ou dans l'exécution du contrat. Pour y remédier, le projet de loi propose de prendre en compte des « considérations relatives à l'environnement » dans les conditions d'exécution, lors de la rédaction des clauses (ce qui est actuellement facultatif). En outre, il ajoute une obligation à l'acheteur de prévoir « au moins un critère lié aux caractéristiques environnementales » dans le choix de l'offre la plus avantageuse économiquement.
Mais à quoi ces critères se rapportent-ils ? « Ils pourront s'appliquer au transport, à l'origine des matériaux, etc », précise Olivia Grégoire. Une définition trop floue, estime Gérard Leseul (PS, Seine-Maritime), qui avait déposé un amendement (rejeté) afin de prendre en compte l'empreinte carbone de la prestation. « Il n'est pas souhaitable d'énumérer l'intégralité des considérations relatives à l'environnement qui pourraient être prises en compte. [...] Il faut laisser aux acheteurs la liberté de choix », avait opposé la secrétaire d'Etat à l'ESSR.
Ne pas contraindre les collectivités
Pour cause, le texte doit « s'articuler avec le code des marchés publics », et éviter des renoncements d'entreprises, notamment les PME, qui devront prendre le temps d'« adapter leur offre aux nouvelles exigences ». « Les acheteurs estiment ne pas disposer d'outils leur permettant de décliner un critère environnemental aux clauses d'exécution dans l'ensemble des segments d'achat. C'est pourquoi le plan national d'action pour les achats publics durables - dont la durée est de cinq ans - prévoit une action de définition et de mise à disposition des outils ».
En la matière, « il reste beaucoup de chemin à parcourir », convient Olivia Grégoire. En 2018, la part des marchés publics annuels incluant une clause environnementale, que le projet de loi rend obligatoire d'ici à cinq ans, s'élevait à 13% pour les collectivités. Pour la secrétaire d'Etat, il ne s'agit pas pour autant de les « contraindre » en fixant depuis Bercy leur liste de commandes.
« Elles doivent choisir ce qui est le plus pertinent pour leur territoire. C'est leur liberté originelle. D'ailleurs, certaines ne nous ont pas attendu pour agir, comme à Strasbourg ou à Bordeaux. La loi ne vient que consacrer ce qu'elles ont déjà poussé, en plaçant au même niveau économie et environnement pour un achat public durable », souligne-t-elle.
Modifier le Code du Travail
Dans un autre registre, les articles 16, 17 et 18 du projet de loi visent à « adapter l'emploi à la transition écologique ». En matière de gestion des emplois et des compétences comme de formations professionnelles, le Code du Travail sera ainsi modifié deux fois pour répondre aux enjeux de la transition écologique.
Faut-il alors « évaluer, refondre et actualiser l'ensemble des formations initiales (...) pour vérifier leur adéquation avec nos objectifs climatiques », comme le proposait, en juillet 2020 dans La Tribune, la députée (LREM) de l'Isère, Marjolaine Meynier-Millefert, pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments ?
« La loi ne doit pas être un catalogue de formations, elle a vocation à dire que la transition écologique doit faire partie des formations », répond Olivia Grégoire. « C'est de plus en plus le cas », ajoute-t-elle aussitôt, citant les 15 milliards d'euros du plan de relance fléchés vers les compétences portés par sa collègue Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Les opérateurs de compétence (OPCO), qui ont remplacé en avril 2019, les anciens organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), seront, ainsi, compétents en matière de formation à la transition écologique.
De la même manière, la secrétaire d'État à l'ESSR vante le dispositif du « VTE vert », le volontariat territorial en entreprise « vert ». Porté par Bpifrance en partenariat avec l'Agence de la transition écologique (Ademe) dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », il vise à encourager, au travers de 8.000 euros d'aides directes, les patrons des PME ou ETI à embaucher des jeunes formés à la transition écologique.
Le texte gouvernemental prévoit enfin que les comités sociaux et économiques (CSE) d'entreprise soient informés sur les conséquences environnementales de l'activité. « C'est indispensable pour que les salariés soient mobilisés dans la transition environnementale », conclut Olivia Grégoire.

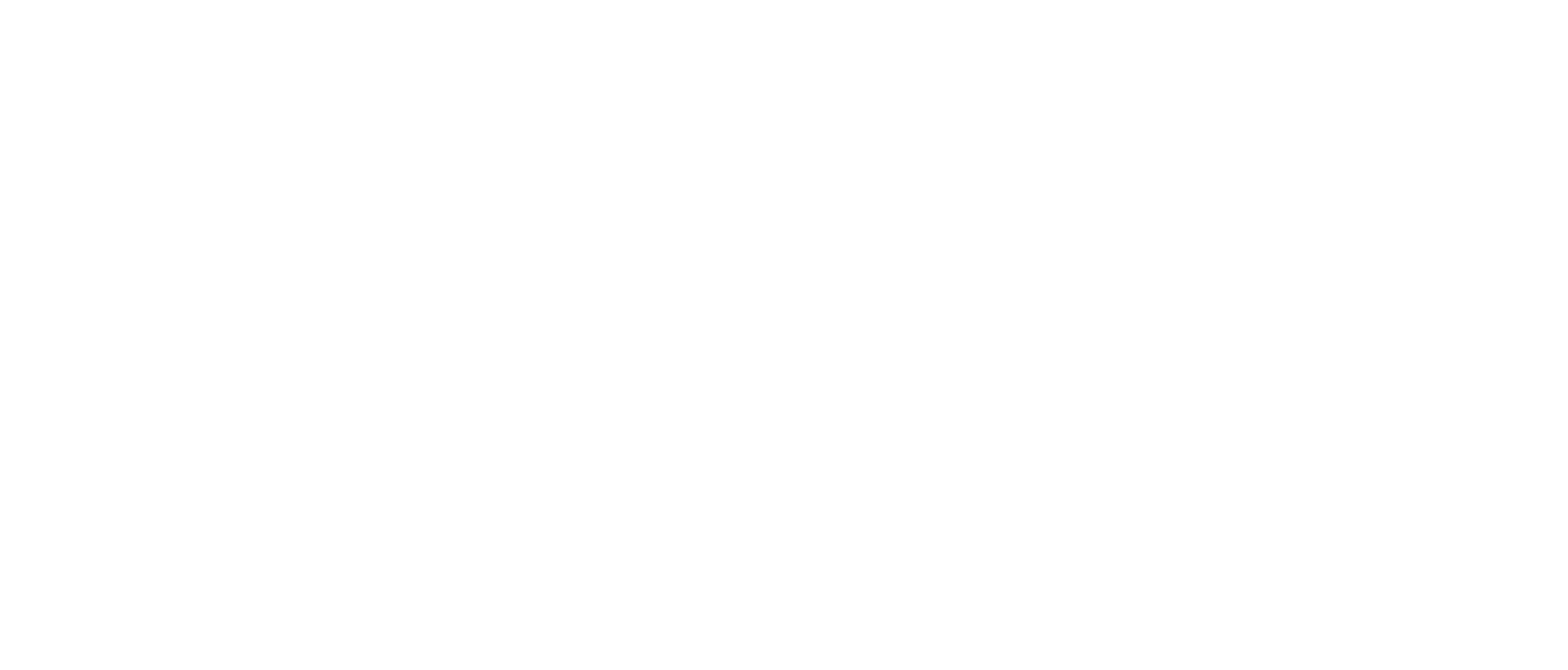
 Les « dark stores » sont bien des entrepôts, le Conseil d'Etat donne raison au gouvernement
Les « dark stores » sont bien des entrepôts, le Conseil d'Etat donne raison au gouvernement

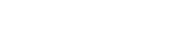
Sujets les + commentés