
Même si les toutes dernières années peuvent donner l'illusion d'un redressement, l'évolution à long terme est inquiétante. C'est ce qui ressort du tout dernier diagnostic de l'élevage, publié par le service Etudes économiques et prospective des Chambres d'agriculture, le 12 septembre dernier. Certes, à court terme, depuis la crise sanitaire liée au Covid et la guerre en Ukraine, la flambée des prix des produits animaux suggère une amélioration de la situation économique de l'élevage français.
« Les éleveurs porcins n'ont jamais connu un prix du kilo aussi élevé », note ainsi l'un des auteurs du rapport, l'économiste Thierry Pouch.
Mais dans les faits, cette hausse des prix s'explique par un déséquilibre sur le marché dû à une tendance qui se confirme année après année : la décapitalisation. Les cheptels français bovins, porcins et ovins ne cessent de se réduire. Résultat: la production diminue depuis quatre à cinq ans, amenuisant l'offre de produits animaux, et ce alors que « la demande, malgré une petite diminution, se tient plutôt bien », constate Thierry Pouch.
« La situation est d'autant plus préoccupante que, depuis les années 1980, on assiste aussi à une diminution incessante des effectifs d'éleveurs, complète l'économiste. On est passé de 175.000 éleveurs laitiers en 1988 à 35.000 en 2020. »
En prenant en compte l'ensemble des éleveurs en France, la chute est moins raide. Elle demeure toutefois impressionnante. Sur la même période, le nombre d'exploitations est passé de 1,017 million à 389.000. La concentration des élevages, notamment laitiers, n'a donc pas empêché la décapitalisation.
Un métier discrédité
Comment expliquer une telle dégringolade ? « La crise économique de 2008 et de 2009, et la sortie des quotas laitiers en 2015, ont sans doute été particulièrement préjudiciables pour le maintien des éleveurs et des troupeaux, avance Thierry Pouch. On a connu des années de crise avec des prix très bas qui ont incité les éleveurs à renoncer à leur métier. »
Plus récemment, un autre facteur est venu s'ajouter, souligne le rapport des Chambres d'agriculture. « Le discrédit qui est jeté sur les métiers d'élevage, en raison de leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre, d'une plus grande sobriété dans la consommation de protéines animales et de la mauvaise perception par l'opinion publique et les organisations non-gouvernementales des bâtiments d'élevage », énumère l'auteur.
Les difficultés et les contraintes du métier d'éleveur rendent également la profession peu attrayante aux yeux des nouvelles générations. Le modèle d'élevage « intensif », visant à augmenter les rendements, qui s'est imposé depuis les années 1950-1960, est de plus en plus remis en cause.
Son remplacement par un modèle extensif, plus vertueux d'un point de vue environnemental, mais moins productif, risque toutefois de compromettre les objectifs de souveraineté alimentaire nationale, alertent les Chambres d'agriculture. Si aujourd'hui la France est toujours autosuffisante en produits laitiers, elle l'est de moins en moins en viande bovine, et ne l'est plus en viande de volaille. Désormais, 55% de la consommation intérieure est satisfaite par les importations, rappelle le rapport.
Une disparition de l'élevage intensif ?
L'étude dessine ainsi trois évolutions possibles pour l'élevage français. Le premier scénario, « de continuité », serait celui d'un élevage de plus en plus critiqué, frappé par des demandes de plus en plus fermes de changement de pratiques et par une réglementation environnementale et sur le bien-être animal croissante. Il impliquerait une influence accrue des ONG, notamment au Parlement européen, avance Thierry Pouch.
« Si ce scénario se confirme, le modèle d'élevage qui s'est affirmé après la guerre pourrait être largement atténué, voire pourrait disparaître. Cela impliquerait des pratiques d'élevage beaucoup plus respectueuses de l'environnement et du bien-être animal, mais en contrepartie aussi un surcroît des importations et une dépendance accrue de la France en termes d'approvisionnement de produits animaux ».
« Ce scénario semble d'autant plus probable que le consommateur est aujourd'hui confronté à des pressions inflationnistes qui l'incitent soit à moins manger de viande, soit à chercher des aliments de moins en moins chers », prédit l'économiste.
Selon l'Insee, le prix des produits alimentaires a encore bondi de 11,1% le mois dernier sur un an, et ceux des viandes vendues en grande distribution de 9,4 %. En conséquence, selon la même source, la consommation alimentaire se contracte fortement : le volume mensuel des achats de produits alimentaires a ainsi baissé de 7,9% entre juillet 2022 et juillet 2023. Et les produits les plus chers sont les plus boudés, comme le montre le recul des ventes des aliments bio.
La consommation de viande des Français, qui tout au long des dernières décennies, grâce à la croissance démographique, a continué globalement d'augmenter malgré une baisse de la consommation individuelle, est susceptible d'être concernée. Et celle de viande française, plus chère, encore plus.
Un « énorme » potentiel international
Le deuxième scénario, qui permettrait un retour à la souveraineté alimentaire dans un contexte de guerre et d'inflation persistantes, impliquerait une véritable inversion de la tendance.
Il exigerait une intervention des pouvoirs publics pour convaincre la population des atouts de l'élevage français, notamment pour l'entretien des territoires et des paysages. Il répondrait aux prévisions mondiales de la FAO et de l'OCDE, qui montrent qu'en 2032 la consommation de viande dans le monde va continuer d'augmenter, sous l'impulsion de la hausse de la démographie et des niveaux de vie :
« Ce qui signifie que si la France n'est pas au rendez-vous. Non seulement notre marché intérieur serait davantage pénétré, mais on louperait aussi des opportunités sur les marchés internationaux », indique Thierry Pouch.
La responsabilité des pouvoirs publics
Le troisième scénario est celui qui cherche un équilibre entre le modèle antérieur, aménagé, et un modèle en ligne avec les attentes sociétales actuelles :
« Il impliquerait une forme de dualité dans les systèmes d'élevage permettant de combiner ces deux dimensions », intégrant des nouvelles pratiques et des filières davantage territorialisées, explique Thierry Pouch.
Mais, comment y parvenir ? Pour certaines productions animales, il s'agirait notamment de mieux rémunérer les externalités positives, en appliquant à l'élevage les dispositifs de la politique agricole commune (PAC) ou du plan stratégique national (PSN) qui le prévoient, estime l'économiste. Il préconise également de renforcer les politiques visant à renouveler les générations, ou encore de développer la présence locale d'abattoirs, qui participent à la réindustrialisation du pays.
Il rappelle, enfin, la nécessité d'avancer sur la réglementation en matière d'indication d'origine et d'étiquetage, et d'appliquer intégralement la loi Egalim I en développant l'approvisionnement de la restauration collective en produits animaux français, voire bio. Une approche qui demande toutefois une « concomitance entre les pouvoirs publics nationaux, locaux et la population ».

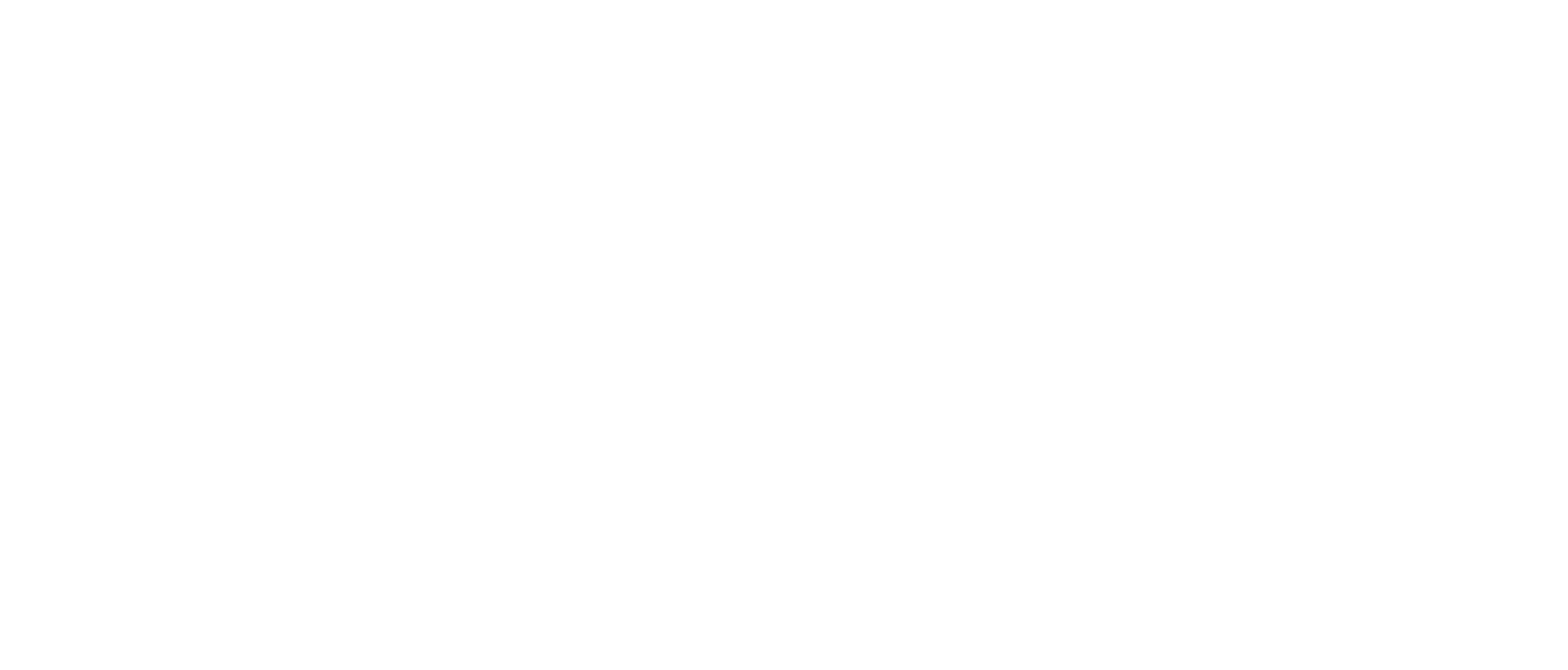

 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville

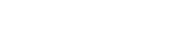
Sujets les + commentés