
Du capitalisme chimiquement pur, cela existe encore. N'en déplaise à tous ceux qui disent que le monde post-covid est en train de sortir de l'idéologie néo-libérale, les propos sans filtre sur le réseau social LinkedIn, de Tim Gurner, patron d'un groupe australien spécialisé dans l'immobilier de luxe, en ont fait la démonstration cette semaine et illustrent le dilemme qu'affronte l'économie mondiale face au retour de l'inflation. « Le chômage doit bondir de 40-50% de mon point de vue. Nous devons rappeler aux gens qu'ils travaillent pour leur employeur et non l'inverse », a déclaré l'entrepreneur australien, avant de s'excuser pour son peu « d'empathie » pour ceux qui perdent leur emploi. Mais à vrai dire, sur le fond, il ne fait que traduire tout haut un sentiment général chez beaucoup de patrons qui ont vu depuis le début de la décennie 2020 le rapport de forces s'inverser en faveur des salariés.
Le télétravail n'est pas seul en cause même s'il y a chez Gurner et quelques autres une volonté de faire revenir ces « fainéants » de salariés au bureau. Interrogez un chef d'entreprise et il ne vous parle que de difficultés de recrutement et de pénuries de travailleurs qualifiés. C'est vrai partout dans le monde : même aux Etats-Unis, le succès indéniable de l'IRA (« Inflation reduction act »), une politique massive de subventions à la transition de l'industrie vers les énergies décarbonées et l'électricité est en train de buter sur le manque de personnel qualifié. En France aussi, c'est le principal obstacle à la stratégie de réindustrialisation.
Preuve que le sujet du rapport de force employeurs-employés est d'une brûlante actualité, la grève dure qui s'engage dans la construction automobile aux Etats-Unis cette semaine. Face à ce conflit social historique, qui succède à celui qui frappe aussi l'industrie du cinéma à Hollywood depuis cet été, le président démocrate américain appelle, à un an de l'élection présidentielle, à un meilleur partage salaire-profit dans l'industrie.
Dans un monde en transition l'emploi devient rare et donc cher et cela dérange visiblement Tim Gurner dans un secteur d'activité, l'immobilier, au bord du krach après des années de spéculation. Mais si son intervention iconoclaste a fait le tour du monde, c'est sans doute aussi parce que sa remarque reflète une part de vérité qu'il va bien falloir affronter : comment faire atterrir -en douceur ou en catastrophe ?- l'économie pour vaincre l'hydre de l'inflation. En réalité, notre capitaliste australien ne fait que rebondir sur les propos de Michele Bullock, la directrice de la banque centrale du pays selon qui le taux de chômage devrait bondir de 3,7 à 4,5% afin de refroidir l'économie, risquant de conduire à 140.000 suppressions d'emplois.
Refroidir l'économie, c'est bien la stratégie suivie par Christine Lagarde, la présidente française de la Banque centrale européenne, lors de l'annonce ce jeudi de la dixième hausse de taux consécutive. Pour tenir l'objectif d'un retour de l'inflation vers le plafond des 2%, contre 5,6%, la BCE assume le risque de provoquer un plongeon de l'économie et donc de faire monter le taux de chômage dans la zone euro. Pour les étudiants en économie, c'est la simple application de la courbe de Phillips qui dit qu'il y a une relation inverse entre la hausse des salaires nominaux et celle du chômage. Ou de la théorie marxiste qui voit dans les chômeurs l'armée de réserve du capitalisme... A chacun de juger.
Reste à savoir si la stratégie d'atterrissage en douceur pilotée par les banques centrales est la bonne. La BCE a révisé en baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro l'an prochain, mais le débat commence à monter au sein du collège des banquiers centraux européens sur le danger d'aller trop haut. En avance sur la BCE, la Réserve fédérale américaine a déjà commencé à marquer une pause en juillet. Christine Lagarde s'est pour sa part bien gardée de s'engager sur une pause, mais pour la plupart des observateurs, le pic des taux d'intérêt est proche, sinon atteint. Du coup, malgré les craintes de récession, l'euphorie l'a emporté sur les marchés financiers européens qui ont salué par une bouffée d'optimisme ce nouveau resserrement du crédit. Les marchés d'actions refusent de voir venir la récession et ont regagné le terrain perdu cet été.
En France aussi, à l'approche de la présentation du projet de budget, Bruno Le Maire s'est résolu à réviser en baisse les prévisions de croissance pour 2024. Mais très modérément, de 1,6 à 1,4%. Le ministre de l'économie et des finances s'est félicité lors d'un déplacement à Berlin, que la presse allemande adresse, une fois n'est pas coutume, des compliments sur la résilience de la croissance française qui tranche avec une Allemagne en récession et en plein doute sur son modèle contrarié par la fin du gaz russe à bon marché. Un bon point en faveur de Bruno Le Maire, son pronostic d'une croissance française à 1% cette année est en passe d'être gagné, malgré un net refroidissement en vue cet automne-hiver selon la Banque de France.
Bref, jusqu'ici, tout va bien, mais deux écueils de taille demeurent. Malgré un début d'inflexion des prix dans l'alimentaire, l'inflation continue d'être trop élevée et la France reste le mauvais élève de la classe européenne sur le front des déficits budgétaires, obligeant Bercy à des contorsions fiscales pour éviter de se retrouver dans une spirale inflationniste. Sur le premier point, le gouvernement cherche à maîtriser le rythme du rattrapage des salaires : le sujet sera abordé début octobre lors de la conférence sociale annoncée par Emmanuel Macron à l'issue du dîner avec les oppositions à Saint-Denis. Et sur le second point, pour éviter de se faire accuser de préparer un tour de vis fiscal, Bercy s'est résolu à indexer le barème de l'impôt sur le revenu, pour un coût budgétaire de 6 milliards d'euros.
Pas question de laisser se propager le sentiment que la douloureuse fiscale va s'ajouter à la morsure de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages, alors que les leaders de la grande distribution agitent le spectre de la « déconsommation », le mot de la rentrée. Une rentrée placée sous le signe de la montée de la grande pauvreté. On a faim en France en septembre 2023, et on a de plus en plus de mal à se loger : deux maux que le gouvernement désargenté est incapable de résoudre. Au point de « faire la manche » auprès du secteur privé, un aveu d'impuissance symbolisé par les 10 millions donnés par la famille Arnault aux Restos du Cœur et par l'amicale pression mise sur Patrick Pouyanné pour prolonger le plafonnement des prix des carburants à moins de 2 euros chez TotalEnergies. Ce qui n'empêche pas Bercy d'envisager de taxer par la même occasion les « surprofits » des raffineries. Après avoir nié en août 2022 l'existence de « superprofits », Bruno Le Maire n'hésite pas à taxer là où cela fait le moins mal politiquement. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, le gouvernement peaufine « une taxation des surprofits » des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Elle pourrait être présentée dans le cadre du budget 2024.
Elle n'aura « aucun impact » sur les péages, a assuré sans rire le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. On attend confirmation chez Vinci et Eiffage... Dans un entretien à La Tribune -lire « L'entretien du Jeudy »-, il a également confirmé des « discussions » similaires concernant une taxe supplémentaire sur les billets d'avion, assumant une hausse de leur prix au nom de la planète. Maigre consolation, les hausses d'impôts sont désormais décidées au nom de l'écologie. Bercy veut aussi augmenter les taxes sur le gaz et mettre fin aux niches fiscales brunes. Bref, la volaille fiscale sera bien plumée, et ne seront épargnés que ceux qui crient plus fort que les autres. C'est ainsi que les transporteurs routiers échapperont à la fin de la détaxe sur le gazole. Après le conflit social sur les retraites, pendant lequel les routiers ont été sympas, il ne faudrait pas que la coupe du monde de rugby soit gâchée par un blocage du pays.
Le gouvernement n'en a pas fini avec ces contradictions. La semaine s'est achevée en mode panique sur la possibilité d'une nouvelle hausse de 10 à 20% des prix de l'électricité en février prochain pour financer le lancement du programme nucléaire français. Immédiatement démentie en coeur par Bruno le Maire et Agnès Pannier-Runacher, cette perspective peu réjouissante n'en reste pas moins au cœur du violent bras de fer qui oppose l'Etat à EDF sur le vrai prix de rachat de l'électricité nucléaire.
Qui veut se convaincre que l'on n'en a pas fini avec les mauvaises nouvelles sur notre pouvoir d'achat n'a qu'à relire le rapport Pisani-Ferry qui chiffrait à 70 milliards d'euros le coût annuel de la transition écologique. Le projet de budget 2024 n'en finance qu'à peine 10%, soit 7 milliards d'euros, laissant dans le flou la façon dont ce grand plan d'investissement sera payé par les entreprises, les contribuables et les consommateurs. Une chose est sûre, la facture sera salée. Et plus elle restera floue, plus il est certain que quelqu'un sera floué. Un peu de transparence fiscale ne ferait pas de mal, car toutes ces nouvelles taxes plus ou moins masquées en cachent beaucoup d'autres à venir. Et cela commence à se voir, sous le vernis de la langue de bois.

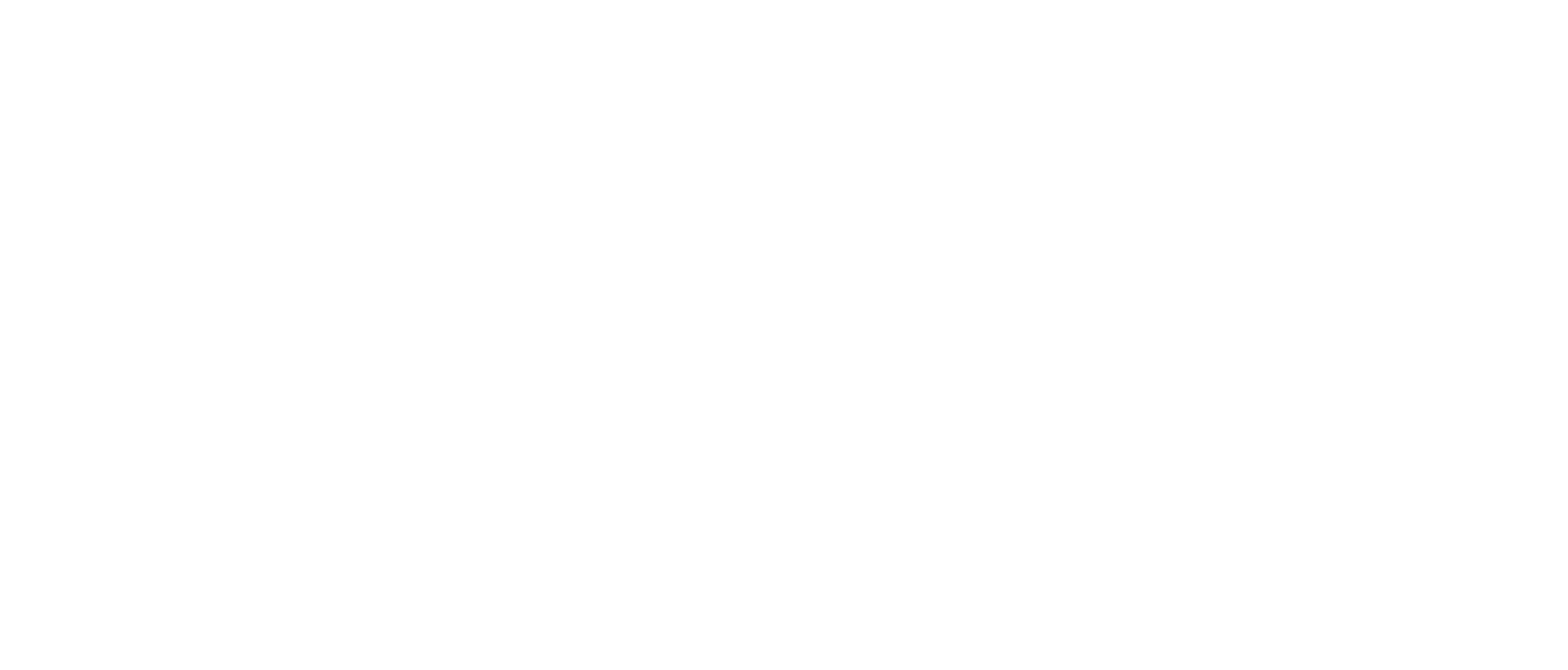

 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville

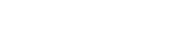
Sujets les + commentés